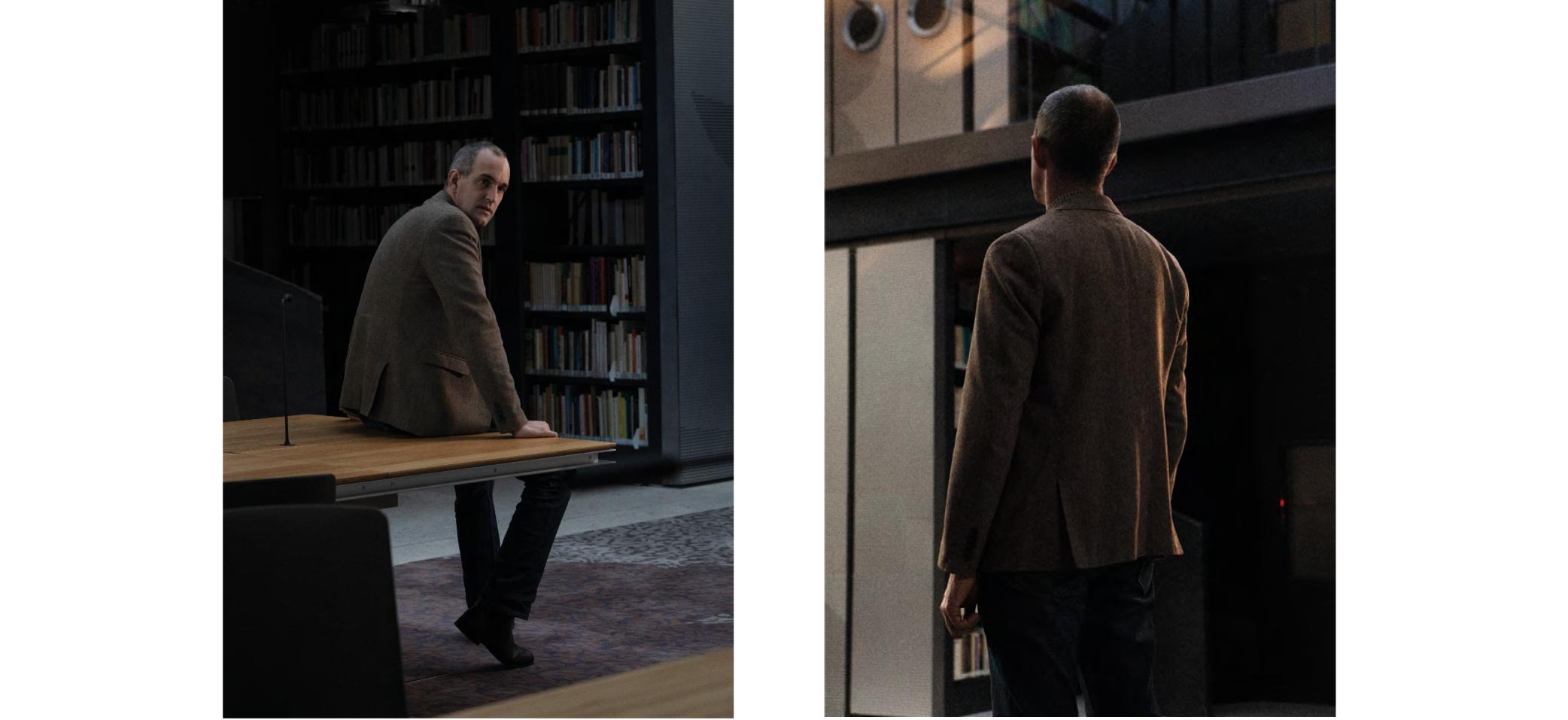Vous pensez le capitalisme comme un système de « mise au travail » généralisé. Pourquoi vous semblait-il nécessaire de faire une différence entre exploitation et appropriation ?
Léna Balaud : « Un patron doit certaines choses à son ouvrier, même s’il l’exploite : la reconnaissance de son travail par un salaire. L’appropriation va plus loin en regroupant toutes les formes de travail invisible des acteurs « fantômes » : celui des femmes au foyer, mais aussi d’une zone humide au fin fond d’une forêt qui, loin des yeux de tous, nettoie l’eau polluée par une exploitation agricole industrielle. Même si ce n’est jamais reconnu comme tel, cette dernière est indispensable aux profits des investisseurs. Si la zone humide ne dépolluait pas l’eau, les entreprises devraient le faire à sa place. Et ça leur coûterait très cher.
Si tout a été mis au travail par l’homme, la nature existe-t-elle encore ?
Antoine Chopot : « C’est le discours de l’anthropocène ou du capitalocène : la nature vierge n’existe plus car la Terre a été complètement envahie par les rapports d’échanges marchands et d’extraction. Même les fonds sous-marins et les pôles sont impactés par le développement économique. Or, cette manière de penser empêche de voir les espaces de résistance et d’altérité ; d’imaginer des alliances avec les non-humains qui ont déjà commencé à réagir. Plutôt que de dire que la nature n’existe plus, nous préférons mobiliser la catégorie de « troisième nature », définie – notamment par des anthropologues comme Anna Tsing – comme tout ce qui parvient à résister et à tisser des relations spontanées et inattendues, malgré la mise au travail généralisée et la destruction des écosystèmes. Par opposition, la première nature renvoie à la nature autonome dont les humains font partie mais qui leur préexiste ; la deuxième nature relève de la manière dont l’économie capitaliste a transformé les écosystèmes en environnements de travail pour qu’ils engendrent du profit : monoculture, OGM, etc.
Le fait d’avoir des plantes ou un animal de compagnie chez soi peut-il être lu comme une forme de nostalgie des liens avec les non-humains, perdus avec l’avènement de la modernité ? Voire une forme de retour de l’animisme dans les villes modernes occidentales ?
L. B. : « Lorsque l’on s’occupe de plantes ou d’animaux, on active sans doute une forme d’animisme, mais cela ne nous permet pas pour autant d’expérimenter la nature comme « altérité à laquelle on appartient ». Puisqu’elles ont lieu au sein de notre sphère domestique, ces relations ne nous permettent pas d’acter le fait que nous ne sommes pas les seuls à être « chez nous » et qu’il existe des espaces qui sont d’abord « chez eux ». On peut mettre en vis-à-vis le chien et la chauve-souris porteuse du coronavirus : la relation domestique au vivant nous conforte dans l’illusion que la juste relation avec les non-humains serait exclusivement de proximité, de soin, de connaissance. Alors que celle-ci peut être tout aussi juste dans la distance, le respect des territoires et le fait de poser des limites à notre désir de tout toucher, d’accéder et d’entrer en relation avec tous les êtres animés.
A. C. : « Cette nature sauvage, nous ne la pensons pas intrinsèquement séparée du monde social des humains, mais plutôt dans son autonomie : les forêts n’ont pas besoin de nous pour exister et prospérer. Prendre soin de cette autonomie, c’est ce que nous nommons, avec Virginie Maris notamment, « le respect du sauvage ». Cultiver des plantes chez soi comble un manque chez les classes urbaines, coupées matériellement, affectivement et sensiblement de ces êtres non humains. Mais on peut hésiter à le faire lorsque l’on sait que les plantes ont des sociabilités interspécifiques, notamment en échangeant des molécules par leurs racines, ce dont on les prive en les cultivant dans des pots individuels.
Si les forêts sont autonomes et les plantes possèdent leurs propres sociabilités, peut- on alors dire que « tout est société », même la nature ?
L. B. : « Nous essayons plutôt d’étendre la question politique au-delà de ce que nous nommons communément « société ». Les rapports de pouvoir concernent un champ plus large, puisque les non-humains aussi sont mis au travail par le capital et que l’autonomie des mondes sauvages est malmenée. Le capitalisme n’est pas seulement un système marchand entre humains, mais bien plus largement une « écologie », pour reprendre un concept de Jason W. Moore : une manière d’organiser les relations entre les vivants qui a pour objectif le profit des classes dominantes. Le « tournant non humain » a tendance à évacuer la question du conflit politique : le monde du capitalisme et celui défendu par ceux qui souhaitent la bonne santé des écosystèmes ne peuvent pas coexister.
A. C. : « De nombreux chercheurs en sciences sociales se sont intéressés aux formes d’organisations non humaines, leurs façons de façonner le monde, avec leurs propres mœurs, leurs propres rythmes, etc. Pour les intellectuels issus du marxisme ou de l’éco-marxisme, ce « tournant non humain » est un aplatissement du monde qui met à égalité toutes les puissances d’agir – humaines, animales, virales, écosystémiques. Pour Andreas Malm par exemple, se débarrasser de la distinction entre nature et société revient à se débarrasser de la capacité, humaine par excellence, à s’organiser intentionnellement et collectivement dans la volonté de faire advenir un état du monde qui n’est pas encore là. Pour notre part, s’il est nécessaire de reconnaître que nous, humains, sommes bien les seuls à pouvoir agir contre les causes de ce qui ravage la planète, nous soutenons que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir opposer une résistance à la mise au travail ni à réparer le monde.
Dans ses évolutions les plus récentes, l’agro-industrie ne met plus seulement au travail les non-humains, mais aussi les relations qu’ils entretiennent entre eux. Qu’est-ce que le « capitalisme régénératif » ?
A. C. : « Certaines avant-gardes de l’agriculture industrielle sont en train de réinventer leur rapport au sol en s’appuyant sur des savoirs écologiques et scientifiques. Les biostimulants, dernières innovations brevetées par Bayer-Monsanto, ont été conçus à partir de l’idée que le sol n’est pas une matière inerte, mais une communauté vivante composée d’une microfaune et de quantité d’insectes dont il s’agit de doper les activités. Cela ne veut pas dire que le capitalisme est devenu écologique. Si les industries tentent de comprendre le plus finement possible le tissu de relations qui compose la nature, c’est toujours aux mêmes fins : produire le plus de récoltes pour engendrer le plus de profits.
Certains souhaiteraient que la participation de ces « acteurs fantômes », comme le sol, soit reconnue par une valorisation financière. En quoi n’est-ce pas suffisant selon vous ?
A. C. : « Cette idée de calculer les « services écosystémiques » rendus par les non humains s’est imposée il y a une vingtaine d’années, pour tenter d’intéresser les économistes à l’écologie en utilisant le langage qu’ils connaissent : celui de l’argent. Cette tentative rend visible la participation des non-humains tout en maintenant une invisibilisation : on s’intéresse, avec une vision utilitariste, exclusivement à la manière dont ils peuvent répondre à nos besoins, et non à la façon dont ils habitent le monde dans leur autonomie. L’exemple des castors analysé par le géographe anglais Jamie Lorimer est très intéressant. En Angleterre, des associations de protection de la nature ont réintroduit des castors pour les mettre au travail en tant qu’« ingénieurs écologiques » : en créant des barrages, ils structurent les cours d’eau et empêchent les inondations. Mais que va-t- il leur arriver s’ils commencent à manifester une indiscipline, à vouloir mener leur vie d’une manière qui ne répond plus au travail qui leur est demandé ?
L. B. : « Le recours à ces calculs permet finalement d’esquiver la question de la dépendance du système capitaliste à la nature et de maintenir des relations d’épuisement, tout en se racontant qu’on en sort. Passer par l’argent permet de ne pas se poser la question de ce qu’on doit aux écosystèmes, à savoir une certaine organisation de nos activités qui ne mutile pas les conditions d’existence des autres vivants. Mais notre objectif va plus loin. Il ne s’agit pas seulement de reconquérir des rapports de bon voisinage avec ces non-humains, il faut trouver de nouveaux alliés, des êtres qui sont déjà en résistance face aux ravages du capitalisme et auxquels nous pourrions associer nos combats politiques : des plantes sauvages qui résistent aux herbicides, des animaux qui « recolonisent » spontanément des milieux, des sols perturbés en ville qui s’enfrichent.

Dans « ces alliances terrestres » auxquelles vous appelez, comment éviter l’écueil de l’instrumentalisation dans lequel tombent les associations anglaises de protection de la nature avec leurs castors ?
L. B. : « Une première chose peut consister à se laisser enseigner par ces autres êtres, se mettre à leur écoute. Ces derniers aussi interprètent leur milieu et perçoivent les conflits entre ses usages, ce que les humains ne sont d’ailleurs pas nécessairement capables de voir depuis leur point de vue. Construire une intelligence de la situation en commun avec ces alliés, c’est prendre en compte leurs différentes capacités, pour éventuellement infléchir nos combats, les termes de ce combat, et définir les adversaires les plus pertinents. Le collectif qui défend la forêt urbaine de Romainville, en banlieue parisienne, a su voir dans la renouée du Japon qui y prolifère – plante dite invasive, mais qui se développe mieux dans des sols remaniés et riches en métaux – une indicatrice de la pollution des sols, et donc des injustices invisibles à l’œil nu que subissent tous les habitants de ces quartiers populaires.
A. C. : « Sur la Loire, à Mardié près d’Orléans, des activistes et naturalistes en lutte ont tenté d’initier une alliance avec un couple de balbuzards pêcheurs, une espèce protégée, pour empêcher un projet de déviation routière et de pont. Ils ont donc construit une plateforme dans la forêt pour qu’ils y fassent leur nid. C’était une invitation : ces rapaces auraient tout aussi bien pu refuser de s’installer. En quoi est-ce une alliance ? Parce que les balbuzards protègent une forêt qu’ils fréquentent depuis une nécessité qui leur est propre, celle de nicher. Et cette alliance fait évoluer les répertoires d’action, puisque la lutte devient saisonnière en se calant sur le calendrier des migrations de ces oiseaux vers l’Afrique.
L. B. : « Dans cette situation-là, se laisser enseigner notre politique par les non-humains, c’est aussi prendre conscience qu’on ne pourra pas défendre la forêt de Mardié sans défendre aussi le fleuve Niger où les balbuzards pêchent en hiver. Cette alliance crée des solidarités internationales.
À l’injonction grandiloquente à « sauver la nature », vous préférez celle de soigner, localement, les écosystèmes.
A. C. : « Cette injonction, qui peut être celle des conventions des Nations-Unies sur les changements climatiques ou d’un président qui appelle à « make the planet great again », maintient l’idée que l’humain serait le seul acteur face à une nature victime et passive. Or nous ne sommes pas les seuls à pouvoir réparer les écosystèmes, bien au contraire. Les vivants sont capables de transformer leur milieu dans le sens du mieux pour tous ceux qui y habitent, même s’ils le font sans intentionnalité. Seules les forêts savent recréer des forêts, seuls les insectes savent recréer du sol et décomposer du bois, seules les feuilles savent faire de la photo- synthèse. Nous sommes dépendants de ces êtres capables de réparer les milieux abîmés grâce aux relations de symbiose qu’ils entretiennent entre eux, comme ces champignons qui, en mobilisant des nutriments dans des sols dévastés par l’extraction minière, rendent possible la pousse de pins sur les terrils. En Allemagne, d’anciens sites miniers où réapparaissent des hirondelles ou des loups sont en passe d’être protégés et conservés en tant que milieux qui s’autoréparent. Après, le danger serait que cette dimension d’auto-guérison vienne légitimer la destruction du monde et les extractions.
Que faire des processus naturels qui, plutôt que de guérir les écosystèmes, empêchent la vie ?
L. B. : « Reconnaître les puissances d’agir réparatrices des vivants indisciplinés ne signifie pas que nous devons nous priver des nôtres. Il y a des situations où, en effet, la meilleure chose à faire serait de faire obstacle à ces processus féraux destructeurs pour la biodiversité locale. La troisième nature dont nous parlions tout à l’heure n’est pas vertueuse en soi, c’est aussi des ravages, des invasions de pucerons dopés à l’azote par la Révolution verte en Asie, ou de criquets pèlerins en Afrique de l’Est ; des situations dramatiques pour des paysans qui subissent inondations ou sécheresses. Mais si on se met dans la peau de celui qui doit gérer les écosystèmes et poser des limites aux « invasifs », on passe à côté de tout ce que ces êtres peuvent nous apprendre.
A. C. : « L’idée de « nature qui se venge » est un leurre. Il s’agit d’écosystèmes qui répondent à leur transformation en environnement de travail. Avant d’être des ennemis, les espèces dites invasives sont le symptôme d’un milieu malade. Il ne s’agit pas de célébrer en soi les ravageurs, mais cette catégorie, comme celle des « nuisibles », est très anthropocentrée : elle vient avant tout témoigner de la manière dont les hommes sont empêchés dans leurs projets.
« Les salariés et les syndicats de Fleury Michon, s’ils veulent lutter pour mieux vivre et mieux habiter la Terre, doivent apprendre à fabriquer des problèmes politiques qui soient communs avec les cochons. » Cette phrase est peut-être le meilleur résumé de votre livre. Quels pourraient être ces problèmes politiques en commun ?
L. B. : « On ne peut pas décréter en soi un alignement des intérêts entre les salariés et les cochons, puisqu’ils sont pris, avec d’autres, dans des relations où ils se nuisent mutuellement. Les salariés exploités doivent enfermer des cochons dans des bâtiments surpeuplés, les gaver de soja OGM cultivé en Amérique du Sud sur des terres volées aux paysans, mettre au travail les zones humides pour épurer les excès de nitrate rejetés qui, au bout de la chaîne, entraînent la prolifération d’algues vertes dans l’océan.
A. C. : « Cette situation concrète nous permet de poser cette question : comment partir de ces chaînes de dépendances pour récréer une cause commune, plutôt que de traiter les questions des conditions de travail, du bien-être animal et de la pollution séparément ? Comment créer une géoclasse salariés-cochons-rivières pour lui donner plus de puissance dans le conflit qui l’oppose à la géoclasse dominante des investisseurs et des dirigeants ?
L. B. : « Si l’on noue ces résistances ensemble, il devient possible d’inventer autre chose. Des élevages non industriels où le travail est bien fait et bien payé, où les cochons voient le soleil et ne sont pas gavés de mono- culture de soja, ça existe. Et ça n’engraisse pas les actionnaires. »
Propos recueillis par Aïnhoa Jean-Calmettes
> Nous ne sommes pas seuls, politique des soulèvements terrestres, éditions du Seuil, mars 2021