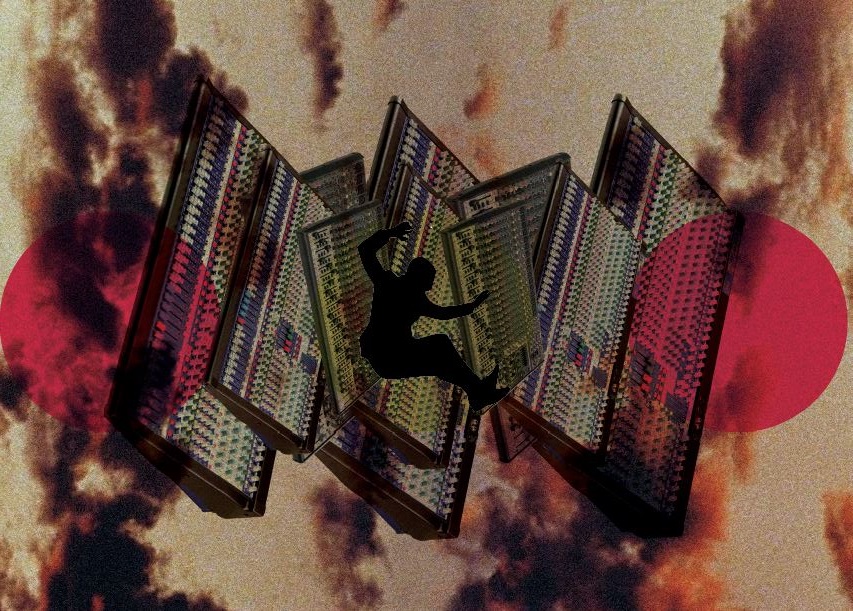« Ok ! Boucle 422 ! », commande Joey Galimi, directeur de plateau, à l’ingénieur du son assis de l’autre côté de la vitre du studio d’enregistrement : un bond dans le long métrage pour aller directement à la prochaine réplique à doubler. Au-dessus de l’image, défile la bande rythmo où s’inscrit chacun des mots traduits en français, selon une typographie qui matérialise les ouvertures et fermetures de lèvres, les souffles, les geignements. « Au début, ces codes peuvent déstabiliser mais quand on double régulièrement, ça devient comme une partition de musique », explique Annie Girard. Au signal du curseur rouge, la doubleuse se fond dans la peau d’une autre. En une fraction de seconde, son timbre change, sa voix perd ses aspérités et se standardise. Sa fine silhouette se décroche de l’obscurité avec la grâce d’un pantin entravé qui mime, les deux pieds ancrés dans le sol, les mouvements de l’actrice originale. « Toutes mes forces de comédienne – la diction, le jeu rapide – se retrouvent en doublage. Par contre, si je dois mettre un masque de clown et jouer, il ne se passera rien. » Dans cette performance, il n’y a aucune place pour l’inattention et l’hésitation. « Parfois, on se présente en studio sans aucune idée de ce que l’on va faire. On connaît simplement le titre du projet, et encore ce n’est pas toujours le vrai… » Il faudra saisir à la volée les informations délivrées par le directeur de plateau sur la situation et l’état du personnage.
La virtuosité sans le glamour
La femme, d’une trentaine d’années, a eu « la piqûre du doublage » alors qu’elle se formait au Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Un stage d’initiation et son adhésion à l’Union des artistes, principal syndicat au Québec, plus tard, voilà qu’on lui confie la voix d’un petit lapin dans un dessin animé. Elle est aujourd’hui celle d’Ellen Page, Charlotte Gainsbourg – lorsque celle-ci ne se double pas elle-même – ou encore Kristen Stewart, depuis son apparition dans Into the Wild. « Étonnement, ça m’a sortie de l’ombre. J’ai donné plein d’entrevues à la radio et à la TV. » Twilight mania oblige. « Je lançais un album en même temps, donc je m’en suis un peu servi pour ma propre promo », admet celle qui officie sous le pseudonyme de Nini Marcelle en tant que chanteuse et musicienne. Un comédien-doubleur nterre toute velléité de consécration : le meilleur des doublages est celui qui ne se remarque pas. Il se réjouit par ricochet quand l’un de « ses » acteurs remporte un Oscar ; pour lui-même, quand on lui offre un premier rôle, « avec beaucoup de lignes [l’échelon de rémunération – Nda] », ou commence à avoir des stars attitrées. « Ces acteurs n’ont aucune idée de notre existence. Ils s’en foutent complètement, et avec raison, mais nous, on est touchés par ce qui leur arrive. C’est complètement absurde. » La séance d’enregistrement matinale touche à sa fin, Annie reprend son sac et salue l’équipe de Cinélume.
L’ambiance est familiale dans ce studio de postproduction créé en 1965, l’un des plus anciens à Montréal. C’est là que les personnages de The Revenant, Ghost in the Shell, Assassin’s Creed, la trilogie des Transformers ou encore des Star Wars ont viré francophones, à l’abri d’un petit immeuble victorien situé dans le quartier de l’université Concordia, le côté plutôt « anglo » de la ville. Dans l’industrie du doublage québécois, les productions américaines – essentiellement des blockbusters – constituent la grande majorité des commandes, suivies par les canadiennes et les britanniques. « Le Québec est considéré comme un marché domestique par les Américains, on fait partie des États-Unis : quand ils sortent un film, ils le sortent simultanément au Canada, c’est la même campagne de publicité. La copie française doit être prête en même temps que la copie anglaise », insiste Joey Galimi. Un long-métrage type s’adapte en un mois en moyenne, détection, adaptation, vérification, calligraphie, enregistrement et mixage compris. Dans les bureaux de Cinélume aux murs tapissés d’affiches de film au kitsch hollywoodien, le directeur de plateau reçoit comme chez lui. Sa filmographie interminable et ses cheveux blancs ramenés en arrière lui donnent une allure de chef d’orchestre. Il l’est d’ailleurs un peu depuis son poste légèrement en retrait dans le studio d’enregistrement : à sa manière de guider les doubleurs – qu’il a lui-même recrutés –, de traquer la synchronie parfaite, d’adapter la traduction en direct s’il lui semble que le mot français sur la bande rythmo ne sonne pas assez naturel ou ne colle pas aux lèvres de l’acteur original. Un air de père de famille éclaire son visage lorsqu’il constate qu’au Canada, principalement à Montréal, l’industrie du doublage fait vivre 500 comédiens et 300 directeurs de plateau, adaptateurs, techniciens, mixeurs et personnel administratif confondus.
Dumping dubbing
Il n’empêche, le marché évolue façon rouleau compresseur. En 2015, les comédiens-doubleurs ont dû accepter collectivement de baisser leurs tarifs de 20 à 30 % pour rester compétitifs. La France se montre beaucoup plus protectionniste : selon une loi de 1949, édictée pour renforcer le cinéma national après-guerre et face à la vague hollywoodienne, pas de visa d’exploitation en version française si le doublage n’est pas réalisé sur le territoire. Seuls les marchés du DVD et de la télévision restent ouverts aux adaptations extranationales. Les salles canadiennes, en revanche, diffusent régulièrement des versions doublées dans l’Hexagone.
« Les acteurs n’ont aucune idée de notre existence ! Ils s’en foutent alors que nous on est touchés par ce qui leur arrive : c’est absurde. » – Annie Girard, doubleuse
Pour Joey Galimi, également président de l’Association nationale des doubleurs professionnels, le problème n’est pas tant le géant parisien Dubbing Brothers ou les boîtes de doublage bon marché qui s’ouvrent en Belgique, en Israël ou au Maroc, que le coup d’État de Netflix, qui passe exclusivement ses commandes en France. « Tout à coup, ils décident que les voix d’ici ne sont pas importantes. En plus de ça, c’est condescendant ! », fulmine-t-il. Avant que la plateforme ne décide d’arrêter les frais, le directeur de plateau travaillait sur les séries Orange Is the New Black et House of Cards. Pour les artistes-doubleurs, l’avenir s’assombrit : Annie Girard compare la situation au Far West tandis que François Godin, la voix indétrônable de Ryan Reynolds, soupire : le doublage ne représente plus que 25 % de son activité en studio contre 80 % il y a cinq ans. Le reste est capté par la surimpression vocale, un procédé de superposition de voix bas de gamme utilisé pour la télévision : « Maintenant il peut s’écouler des semaines entières sans que j’aille en studio… Il faut espérer que le gouvernement fédéral à Ottawa ait une énorme empathie pour nous. Ici, c’est l’Amérique, il n’y pas de régime d’intermittence… »
Le comédien-doubleur s’avoue pourtant chanceux. Il vient de terminer le dernier Deadpool. Et de lâcher, avec un rire : « Dans la vie, j’ai l’air d’un bon garçon tranquille, pas forcément drôle… Ça a pris un certain temps et quelques auditions pour qu’on s’aperçoive que j’avais le type de voix et le timing nécessaire pour faire des rôles comiques. » Conséquence : « 30 ans de carrière dans l’ombre » pour celui qui se rêvait écrivain et a commencé le doublage pour subvenir à ses besoins. Sorti du conservatoire de Montréal à 24 ans, il a évolué avec « ses » acteurs, appris à capter les subtilités de chacun et à décoder les informations logées dans leurs expressions de visage : Steve Carell « à la voix nasillarde », Will Ferrell « qui a des cordes vocales en acier », Roger, l’extraterrestre « complètement disjoncté » dans le dessin animé American Dad ou encore Ewan McGregor, « royalement ennuyeux » en Obi-Wan Kenobi. François Godin module sa voix à mesure qu’il établit la liste. « Le métier s’apprend comme apprend un enfant, par imitation. L’acteur a fait le travail, il nous faut le rejoindre de manière immédiate, travailler une espèce d’oreille musicale. Après, on le garde en soi. » Son rêve ? Se faire un nom auprès des éditeurs pour publier ses textes façonnés par l’oralité. À défaut, travailler sur un Woody Allen, dont les films « très verbo-moteurs » sont exclusivement doublés… en France.
Langue officielle-artificielle
Doubleurs et directeurs de plateau s’accordent à dire que le doublage favorise la « démocratisation » du cinéma.
Pourtant, au Québec, la maîtrise de l’anglais progresse, le taux de bilinguisme avoisinant les 50 %. Mais un chiffre en cache un autre : plus de 50 % des Québécois sont considérés comme analphabètes fonctionnels. Éric Plourde, traducteur enseignant à l’université de Montréal, rit : « Parler de démocratisation revient à adopter le même discours qu’en France : “le doublage, c’est pour la plèbe”, un outil de distinction sociale. Au Québec, il a beaucoup été utilisé comme un rempart contre l’anglais, quasi omniprésent. Le fait qu’on parle encore français ici est en partie dû à cette pratique. »
« Au Québec, le doublage a beaucoup été utilisé comme un rempart contre l’anglais. Le fait qu’on parle encore français ici est en partie dû à cette pratique. » Éric Lourde, linguiste
Même si l’« esprit de clocher » transpire dans la Belle Province, un comédien-doubleur canadien doit adopter une autre langue, débarrassée de toute forme de particularisme : le « français international ». Une pure invention de l’industrie, dont le souci de crédibilité vise aussi à élargir au maximum l’audimat et les profits générés par un film. « Dans cette perspective-là, on ne va pas commencer à faire des expériences linguistiques », ironise le traducteur, originaire d’une ville minière en Abitibi-Témiscamingue. « Il y a des pays qui ont volontairement choisi le doublage, pas seulement parce que c’était moins cher qu’un remake [une spécialité des riches majors américaines – Nda], mais parce qu’ils voulaient imposer une seule langue. » Ce ne serait pas un hasard si les industries de postproduction les plus prospères ont fleuri dans la France coloniale – où le doublage a été promu par l’ancêtre du CNC sous Pétain –, l’Italie fasciste, l’Espagne de Franco et l’Allemagne nazie. L’adaptation audiovisuelle est affaire de consensus, quitte à neutraliser une langue ou perpétuer certains clichés. « La manipulation du texte se fait à toutes les étapes, même dans le choix des voix », poursuit le traducteur, endurci par son expérience de doubleur pour une chaîne de télévision érotique : une voix grave, censée être plus virile, pour un héros ; le français québécois cantonné à une seule couche sociale, ouvriers ou non éduqués.
Francophonie (non -)alignée
Quand le doublage prend son essor au Canada dans les années 1970, le modèle du bien-parler s’aligne sur Paris. « Il fallait que tout le monde parle à la française », se souvient Christine Séguin, adaptatrice et directrice de plateau sur plus d’une centaine de films. Pour les spectateurs de sa génération, John Wayne ou Tony Curtis s’expriment à coup de « Magne-toi connard » et autres « Bastogne dans le buffet », que cela ait ou non un sens à leurs oreilles. En parallèle, le « joual » – sociolecte des quartiers ouvriers de Montréal – se répand face à la francophonie promue par les institutions. « Grâce à cette contre-culture, on n’a plus eu besoin d’être plus français qu’un Français pour travailler à Radio Canada. Mais en doublage, quand ça tire vers le joual, c’est très mauvais… » La directrice de plateau évoque avec le ton d’un vétéran une version catastrophique d’Ally Mcbeal. Aujourd’hui, les commandes de certains distributeurs canadiens évoluent au profit d’une couleur plus locale, correcte et sans caricature. Christine Séguin se réjouit d’avoir été pionnière sur The Trotsky réalisé en 2010 par le Canadien Jacob Tierney. En première voix : Xavier Dolan pour l’étudiant montréalais persuadé d’être la réincarnation de Léon Trotski. Mais ce genre d’expérience, facilitée par un contexte scénaristique propice, reste rare. Seul le domaine de l’animation autorise le français québécois à percer sur les écrans, et aux comédiens-doubleurs une part d’excentricité. À écouter Gilbert Lachance interpréter, à la chaîne, ses personnages attitrés dans Les Simpson, cela ne fait aucun doute. Par contre : « Personne n’a envie que Robert De Niro ait l’air d’avoir grandi à Québec ! »
Le doublage contre-attaque
Le décor luxueux du café où Gilbert a donné rendez-vous, sis dans une ancienne banque du Vieux-Montréal, détonne avec l’étiquette « dégradante » que le cinéaste René Clair, pour ne citer que lui, avait collé au métier. « Il y a 25 ans oui, le doublage était fait pour ceux qui n’étaient pas capables de trouver un rôle sur scène ou dans une série. Aujourd’hui, les grands comédiens veulent en faire », certifie-t-il, la carte Xavier Dolan et Anne Dorval dans la manche. Après des années passées dans l’ombre de Tom Cruise, Johnny Depp, Josh Brolin ou encore Matt Damon, le doubleur réapprivoise les planches et caresse l’ambition de lancer ses compositions musicales sur le marché. « Ça a été un peu déchirant quand j’ai dû décider, jeune adulte, de devenir pianiste ou comédien », glisse-t-il. Soigneusement gominé, en veste de costard et jean décontracté, Gilbert Lachance sirote un café tout en dissertant sur le savoir-être « antivedette » : le doublage serait un art à part entière, « ce que les Américains n’aiment pas du tout, parce que pour eux, un film, c’est un produit ». Le lancement d’un logo « Doublé au Québec » à accoler sur les jaquettes de DVD se charge de le promouvoir aux yeux des consommateurs. À croire que dans le cirque du libre-échange, les voix locales des stars hollywoodiennes ne peuvent espérer d’autre salut que celui d’un roquefort
labellisé AOP de l’autre côté de l’Atlantique.
Texte : Orianne Hidalgo-Laurier, à Montréal
Illusrtations : Félix Salasca, pour Mouvement
Lire aussi
-
Chargement...