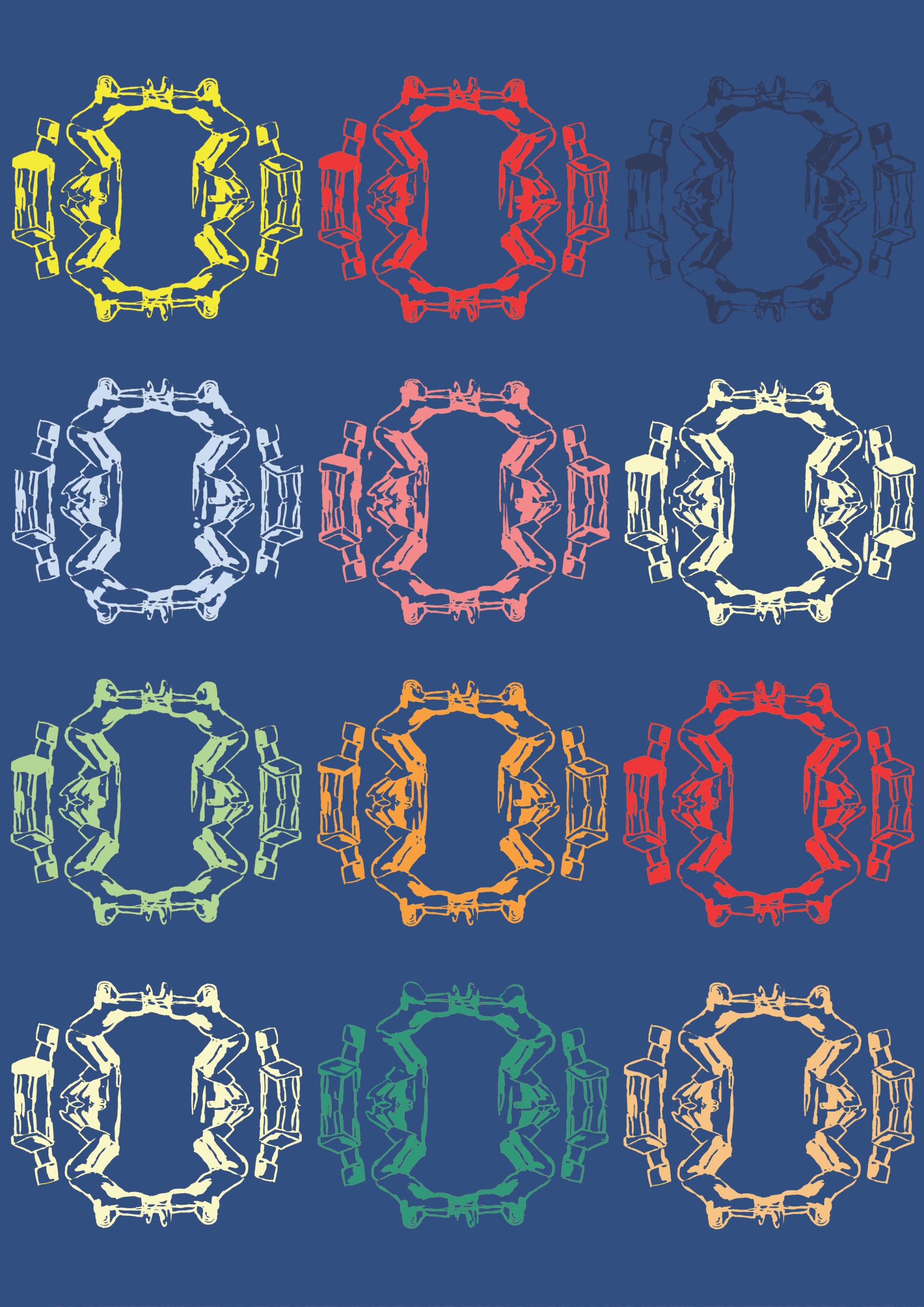L’usage des œuvres, une vidéo publiée anonymement sur Internet, a eu l’effet d’une bombe dont l’onde de choc s’est propagée au-delà du petit monde du cirque contemporain. Par un cut-up habile, celle-ci accuse Yoann Bourgeois, prince de la discipline en France, d’avoir grossièrement plagié des artistes moins connus que lui pendant plus de cinq ans, dans une indifférence générale. Dix minutes durant, des extraits de ses spectacles sont confrontés à ceux d’une dizaine d’autres, plus anciens : il est peu dire que les ressemblances sont choquantes. Emprunt, vol, citation, hommage ? Ce montage vise-t-il à dénoncer un pilleur d’idées sans vergogne, ou est-ce une tentative brutale de faire tomber l’étoile de son piédestal ? Les avis divergent. Mais cette polémique raconte aussi une autre histoire : celle d’un milieu artistique empêtré dans ses contradictions, qui peine à se mettre d’accord sur ce qu’est réellement, au fond, une œuvre.
La propriété, c’est le vol
Prononcer le mot « plagiat » nous projette instantanément sur un terrain miné : celui de la propriété. Dans un environnement qui valorise sans cesse la création collective et la circulation des idées, affirmer qu’un geste, une technique ou un enchaînement est sien ne se fait pas. Historiquement, c’est d’ailleurs pour encadrer la bonne diffusion des œuvres et la rémunération des auteurs, que la propriété intellectuelle est conceptualisée. En aucun cas pour arbitrer un éventuel litige. La ligne de défense de Yoann Bourgeois, déroulée dans une tribune publiée sur le site d’Artcena (Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre), s’articule précisément autour de cet argumentaire. « Tout artiste s’inscrit dans une histoire dans laquelle il puise et à laquelle il contribue », écrit-il.
Sur le papier, personne n’aurait l’idée de contester ce point. D’autant plus que, la plupart du temps, ces emprunts, reprises et citations se passent sans embûches. Lorsque Juan Ignacio Tula est entré à l’école du Centre National des Arts du Cirque (CNAC), à Châlons-en-Champagne, il était encore l’un des rares à travailler la roue Cyr, ce grand cerceau métallique de près de deux mètres de diamètre. En quelques années, il a vu avec joie cette technique se démocratiser : « Beaucoup d’artistes s’inspirent de ce que j’ai développé pour proposer de nouvelles figures. Ça me paraît tout à fait normal, d’autant qu’ils manifestent du respect pour le travail de ceux qui les ont précédés.» Lorsque la chorégraphe et acrobate Chloé Moglia donne des workshops, elle entend livrer tous ses tricks et ses techniques. « La suspension appartient à tout le monde : il faut juste tenir bon, devenir apprentie guenon. Et là, je me suis surprise à vouloir défendre mon espace, alors qu’en soi je prône la cohabitation. Je n’ai pas envie d’être une artiste qui défend son territoire en bonne petite propriétaire.» La mise en regard de sa pièce En suspens avec celles de Yoann Bourgeois – Celui qui tombe et Minuit – ouvre en grande pompe la vidéo anonyme. Directement impliquée dans l’affaire, l’experte de la suspension s’est trouvée profondément mal à l’aise. « Je pars du présupposé que chacun est déjà sur un chemin, en réflexion et en travail. Ce travail transforme les emprunts, apports et filiations. Ce n’est pas le cas avec Yoann. C’est la première fois que je suis confrontée à ce genre de rapports de prédation, au sens de prendre sans transformer. »
 Bienvenue dans la jungle
Bienvenue dans la jungle
Si les idées appartiennent à la fois à tout le monde et à personne, pourquoi l’histoire de Yoann Bourgeois a-t-elle autant choqué ? Pourtant enclin à considérer que « rien ne se crée, tout se transforme », Antoine Defoort s’est lui aussi senti coincé dans une forme de « dissonance cognitive » lorsqu’il a pris connaissance de l’affaire.« Chiffonné » par la question du droit d’auteur depuis longtemps, le metteur en scène en a fait en 2016 le sujet d’Un faible degré d’originalité, une conférence-performée aussi drôle que savante. « L’écriture de spectacles relève pour moi de l’assemblage, du bricolage, de l’agencement d’idées, d’émotions et de concepts. Mais cela ne m’empêche pas de ressentir le besoin légitime d’être reconnu pour ce travail. En théorie, je suis un peu agacé par la mystique de l’artiste sorcier ou demi-dieu. Dans la pratique, ce n’est pas si facile de laisser partir les choses que l’on a créées. »
La question de la reconnaissance vient donc légèrement déplacer les enjeux. «Le problème c’est quand deux artistes n’ont pas le même poids et le même rayonnement, et que le plus visible s’inspire de l’autre » explicite Justine Berthillot, par ailleurs flattée par toutes les vidéos d’étudiants qui tentent de reproduire les figures acrobatiques qu’elle a élaborées avec son partenaire, Frédéri Vernier. Chloé Moglia s’interroge : « J’ose espérer qu’avant la publication de L’usage des œuvres, certains programmateurs s’étaient alertés des copiés-collés de Yoann Bourgeois... Mais une grande partie du milieu a investi sur lui, en dépit de ses “agencements” quand même très visibles. Il y a sûrement besoin de cette figure du jeune génie, l’Artiste comme nouveau Rimbaud, produit par le milieu comme fabriquant à partir de rien. Faire ça, c’est nier tout ce qui a existé avant. »
La chorégraphe Joanne Leighton, chargée de la danse et de la musique à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), pointe elle aussi avec inquiétude la responsabilité collective. « Cette polémique nous concerne tous, et à tous les niveaux : des relations de travail, au financement de la création, jusqu’aux choix de programmation. C’est une question éthique et nous aurions grand intérêt à ne pas nous asseoir dessus. » Pour la metteure en scène Eva Doumbia, le plagiat est avant tout une question de rapports de pouvoir.
« À partir du moment où quelqu’un est en place, il peut se permettre de plagier et de récupérer.» Et être en place n’a pas toujours grand-chose à voir avec la qualité du travail. « On pense souvent que c’est l’œuvre qui fait le grand artiste. Je pense plutôt que c’est son accès aux moyens de production et sa relation avec les politiques.»
Dans les arts du geste, la logique du premier de cordée a la peau dure. Alors qu’une poignée de noms du cirque se partage quelques grosses enveloppes – une dizaine d’artistes peut espérer faire valider des projets à plus de 400 000 euros chaque année –, les autres doivent se contenter des miettes, avec des aides de co-production souvent inférieures au millier d’euros. Au lieu de tendre vers une répartition plus égalitaire des moyens de production, les institutions, soucieuses de toucher un plus large public, renforcent ces logiques en érigeant quelques rares élus en chefs de file. « Nous avons besoin de figures pour faire connaître davantage cette mouvance encore mal appréhendée qu’est le cirque. D’artistes qui vont ouvrir la voie à la génération suivante », explique Gwénola David. De l’école du CNAC à la direction d’Artcena, elle a consacré une grande partie de sa carrière à structurer ce champ artistique, dont Yoann Bourgeois est rapidement devenu le meilleur espoir. Soutenu depuis une dizaine d’années par les institutions, il est le seul artiste de cirque jamais nommé à la tête d’un Centre chorégraphique national (Grenoble). Sa renommée, construite grâce à de nombreuses tournées, en France et à l’étranger, lui a permis de faire des excursions du côté de la chorégraphie de clips, notamment pour Vincent Delerm ou Missy Elliott. On murmure ces derniers temps qu’il serait pressenti pour mettre en scène une cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.
Jouer son cachet au tribunal
Pourquoi les artistes cités dans la vidéo L’usage des œuvres n’ont-ils pas porté plainte ? La question est sur toutes les lèvres. Du côté des personnes choquées par la somme des « emprunts » supposés de Yoann Bourgeois, mais aussi du côté de ceux que la situation embarrasse. « Quand il y a un plagiat avéré, ça se règle devant le tribunal », lâche Gwénola David qui s’est sentie troublée par les images, mais aussi manipulée par le montage et le caractère anonyme de la vidéo publiée. Faute d’enquête sérieuse, elle préfère en appeler au calme des esprits et à un débat apaisé.
Pas de procès, pas de problème ? Comme souvent, dans les faits, c’est plus compliqué. Les attaques pour contrefaçon sont « rarissimes » dans le milieu de la culture, nous explique l’avocat Roland Lienhardt. Lancer une procédure, « c’est la galère » » : difficulté à établir l’antériorité d’une œuvre ou son caractère d’originalité », sur lequel se fonde juridiquement la propriété intellectuelle, hésitations sur le tribunal à saisir, lacunes des juges dans la connaissance précise du droit d’auteur… Lorsqu’un artiste qui se sent lésé sonne à la porte de son cabinet spécialisé dans la création artistique, il se sent le devoir de le décourager. « Si vous êtes très riches et que vous avez beaucoup de temps, vous obtiendrez gain de cause. Si et seulement si. D’autant plus que dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, il est légal d’emprunter une œuvre préexistante si on le justifie par un discours intellectuel. La liberté d’expression prime sur la protection des droits. » En plus de vingt ans de carrière, l’avocat ne peut citer qu’une seule affaire dans laquelle la contrefaçon a été reconnue comme telle : Philippe Decouflé, grande figure de la danse contemporaine, a été condamné pour avoir intégralement repris une gestuelle de la compagnie Les Elastonautes dans la cérémonie d’ouverture des JO d’Albertville en 1992, qu’il avait chorégraphiée. « De fait, il a eu raison de le faire. Decouflé été condamné des années plus tard à 30 000 euros de dommages et intérêts : ridicule ! Grâce à cet événement, il a obtenu une renommée mondiale…» Les Elastonautes, eux, se sont grillés.
Être ou avoir
L’avocat Roland Lienhardt nous avait prévenues : « La loi est très claire en France, très protectrice en thé-o-rie. Dans la pratique la seule loi, c’est celle de la jungle. Quand un artiste débute, s’il n’est pas “ fils de”, il se fait exploiter de tous les côtés. Une fois qu’il a compris le système, il exploite les autres à son tour. Il garde sa casquette d’artiste, mais dans les faits, il faudrait plutôt parler de producteur, ou d’éditeur. » Le plus fort a non seulement la possibilité de plagier sans être inquiété, mais aussi l’autorité nécessaire pour imposer les termes du débat. Emprunt, vol, citation ou hommage, nous demandions-nous ? Tout dépend de la définition que l’on donne de la création et de l’endroit où l’on situe l’auteur, dans des spectacles qui s’écrivent souvent collectivement et dans des formes hybrides jamais définitivement fixées. Pour Yoann Bourgeois, mis en accusation par la vidéo, « l’histoire de l’art est une suite infinie de réinterprétations et de détournements d’idées, de motifs, de références. » Chloé Moglia y voit un « contre-récit » de l’histoire de l’art. « Faire œuvre sur la base de “motifs”, c’est comme dire que l’on compose des poèmes à partir d’un alphabet que d’autres, en bons ouvriers du langage, auraient fabriqué. Le problème, c’est que moi, je ne construis pas un “alphabet” au service de créateurs. Je travaille un principe : la suspension.» Pour la circassienne, créer ne se limite pas à la conception d’objets artistiques dont nous serions, ou non, propriétaires. La création s’envisage davantage comme un processus de recherche, qui nous façonne autant qu’il donne sens au monde. Dans cette perspective, le plagiat ne consiste pas à s’approprier le geste d’un autre mais à transformer ce geste en « marchandise », à basculer de l’être à l’avoir. « Le plagiat touche à la subjectivité, au fait de vider une forme de l’expérience qui l’a façonnée, précise Eva Doumbia. Le même mécanisme est à l’œuvre lorsqu’un groupe dominant s’empare d’une problématique, d’une forme artistique et culturelle qui ne le concerne pas, simplement pour en tirer des bénéfices… »
Créer, c’est mettre de soi. « S’autophagocyter, devenir le vampire de soi-même », nous dit le chorégraphe Olivier Dubois. Ces lignes, pourtant, ne sont pas toujours aussi claires. Lorsqu’il part à la rencontre d’un groupe de jeunes danseurs et chanteurs de mahraganat dans les rues du Caire, c’est bien pour ce qu’ils sont qu’il va les convoquer sur scène, invoquant leur énergie et leur talent brut. Il n’en reste pas moins que l’auteur, c’est lui. Et seulement lui. « La question de la part auctoriale des interprètes est ridicule, c’est un mauvais combat. J’en connais qui disent : “ On a apporté toute la matière.” Bah oui, c’est normal. C’est de l’artisanat, on arrive avec son savoir-faire. », explique-t-il. « S’il s’agit de partager les droits d’auteurs, partageons la prise de risque dès le départ. Mais qui va au combat ? Qui prend les foudres et va chercher l’argent ? Qui garantit une fidélité porteuse de l’œuvre ? » À rabattre la question de l’auteur sur celle du porteur de projet, ne bascule-t-on pas dans autre chose ? Un statut de producteur-auteur, encore à inventer ?
 Penseurs du corps
Penseurs du corps
Du côté de la jeune génération, d’autres modèles tendent néanmoins à poindre, plus horizontaux. Le collectif (LA)HORDE surfe sur une conception de l’interprète comme « penseur du corps », et d’un travail de création qui se ferait dans la rencontre. Il y a 10 ans, le trio faisait de la techno jumpstyle le terrain de ses premières explorations artistiques, s’intéressant autant à la technique de ses danseurs qu’à la communauté qu’ils forment. « Nous avons rencontré des “ambassadeurs” du jumpstyle qui ont décidé de ce qu’ils allaient nous transmettre ou non, de ce qu’on allait pouvoir utiliser dans notre spectacle. Cette négociation, c’était le début d’un dialogue. » Loin d’une simple juxtaposition d’éléments prélevés et déplacés sur scène, To da bone est la transformation, en fiction, de leur dialogue avec des membres de ce groupe. « Pour l’anecdote, si vous posez la question aux danseurs avec qui on a bossé, To da bone n’est plus du jumpstyle. Au moment même où ils ne dansent plus de profil, ça devient autre chose pour eux : un vocabulaire commun que l’on a forgé ensemble, en se déplaçant chacun un peu », expliquent-ils d’une même voix. En arrivant à la tête du Ballet national de Marseille, ils ont d’abord sécurisés leurs interprètes. Pas en partageant les droits d’auteurs : en les salariant en CDI. Le trio (LA)HORDE met un point d’honneur à les présenter chacun, individuellement, dans les livrets qui accompagnent les spectacles. Ils marquent une pause, songeurs. « C’est drôle, c’est comme si dans la danse on était soudain plus perdus que d’autres sur ces questions-là. Quand tu vas au cinéma voir un film avec Isabelle Huppert, c’est aussi pour elle, sa posture, sa voix, son regard. Ce qu’elle sait faire en tant qu’auteure. »
Pour la chorégraphe Maud Bandel, en revanche, partager son statut relève d’une « absolue nécessité ». Après s’en être d’abord tenue à la conception classique de l’auteur unique, largement encouragée par le cadre administratif, elle s’en est éloignée. Au fil de ses collaborations avec la danseuse Maya Masse, elle s’est rendue à l’évidence : plus qu’un simple support charnel, le « traitement » du geste réalisé par Maya participe de l’écriture de la pièce. « J’ai accepté le fait que ce n’était pas mon propre corps qui produisait le mouvement, et que je convoquais les danseurs aussi en tant qu’auteurs. » Pour Divertimenti, Maya est créditée comme co-auteure, par souci de fidélité à leurs réalités de travail : d’un côté, un processus d’écriture « de l’intérieur » qui passe par la gestuelle, à la charge de l’interprète. De l’autre, une écriture de « l’extérieur », depuis la perception. « Est-ce que tu trouves ça juste ? » demande l’une à l’autre. « Ben oui, je trouve ça juste. Et toi ? »
Texte : Agnès Dopff, Lena Hervé et Aïnhoa Jean-Calmettes
Illustrations : Émilie Seto pour Mouvement
Lire aussi
-
Chargement...