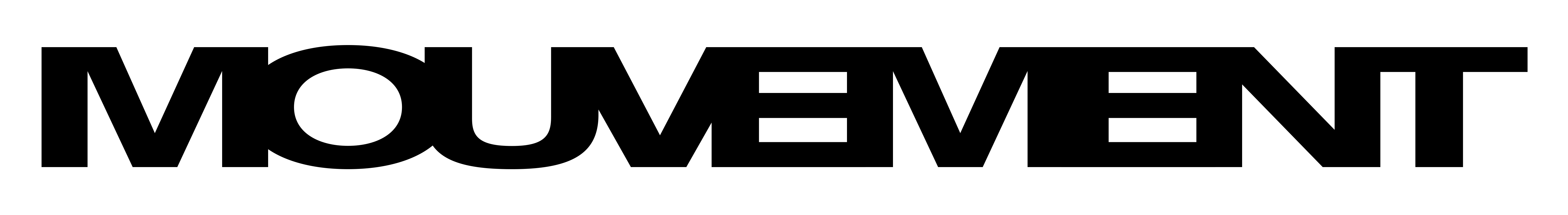En Italie, l’extrême-droite a confisqué la culture en deux temps, trois mouvements. Comment ? La gauche avait déjà bien abîmé la démocratie ; le cinéma et la télé pondent du contenu patriotique sur commande et sans discuter. Mais la jeunesse précaire n’a pas fini d’ouvrir des squats et d’inventer des formes. Regardons chez les autres pour mieux balayer devant notre porte.
Un reportage extrait du N°122 de Mouvement
« Après son élection, le gouvernement Meloni a tenu une grande conférence de presse sur “l’état de la culture de la nation” qui passait en revue toutes les disciplines. Arrivés au chapitre du théâtre, ils nous ont servi à peu près ce discours : “nous devons retourner au théâtre classique car le contemporain est noyauté par le lobby LGBT.” Le projet de Meloni, comme celui des fascistes d’antan, est de s’enraciner partout, de germer dans tous les interstices. Ils s’y préparent depuis longtemps et leur plan est parfaitement ficelé. » Il est 17 heures, un dimanche en débardeur : le spectacle va commencer au Teatro Argentina, célèbre théâtre romain construit sur les ruines du site où Jules César fut poignardé dans le dos. Des dames en tailleur rose et chapeau voilette se pressent sur le parvis. Des hommes en costume noir surveillent la scène depuis le premier balcon avec un air inquiet. L’assemblée constituante des travailleur·ses de la culture a promis une « action », un truc gentil avec musique festive et brèves prises de parole, mais qui lui a déjà valu quelques démêlés avec l’antiterrorisme ces derniers mois. L’assemblée est mobilisée depuis le 20 janvier : ce jour-là, une partie du conseil d’administration du Théâtre de Rome, qui regroupe trois scènes contemporaines, se réunit en secret et nomme un allié de Meloni au poste de directeur. Le maire de centre-gauche de la capitale, financeur majoritaire, n’est pas convié. La gauche parle d’une « occupation illégale ». La presse dénonce un « blitz » et une procédure en justice est engagée. Depuis, la police fiche les membres de l’assemblée qui tractent devant les théâtres. Leur revendication est inscrite sur une grande banderole rouge : « Vogliamo tutt’altro » – « nous voulons tout autre chose » – un détournement du slogan du puissant mouvement ouvrier italien des années 1970 « Vogliamo tutto » – « nous voulons tout » : de meilleurs salaires et le meilleur whisky, la retraite à 20 ans et la Révolution. On en demande moins aujourd’hui. Le mouvement social en est à sauver de vieux meubles : l’antifascisme, relique de la victoire des partisans en 1945, qui fonde la constitution italienne ; et le droit du travail, en perpétuelle érosion.
La prise du Théâtre de Rome est à l’image de l’offensive menée par le gouvernement Meloni contre les institutions culturelles : depuis un an, l’extrême-droite a raflé le musée d’art contemporain MAXXI de Rome, la Scala de Milan et la Biennale de Venise, qui chapeaute notamment la Mostra. Les statuts du Centre Expérimental du Cinéma, école prestigieuse et archives nationales, ont été modifiés, autorisant le gouvernement à nommer le comité scientifique, en plus du conseil d’administration. Le personnel de la RAI a été renouvelé en profondeur. Les studios historiques de Cinecittà sont dirigés par une proche du pouvoir qui préside aussi l’Association des Producteurs de l’Audiovisuel. Si personne n’est surpris par la démarche, on s’étonne quand même de la rapidité de ces changements. « En Italie, il n’y a aucun garde-fou, aucune protection légale, et la précarité des travailleur·ses est la condition d’existence première du système culturel, souligne l’assemblée. Ça en dit long sur la vacuité des institutions. » C’était presque trop facile. Par ailleurs, le terrain idéologique est fertile et le ver fasciste avait déjà bien entamé la pomme : un certain nombre de secteurs clés étaient déjà acquis à l’extrême-droite. Meloni s’est contentée de vaporiser un parfum d’outrance avec des procédures à la limite de la légalité. Prise de court, l’opposition – incarnée pour l’instant par les mouvements transféministes et les milieux culturels précarisés – a mis un moment à se structurer, mais nous y sommes.
 |  |
MON CÂBLE USB EST DE DROITE
« La première assemblée s’est tenue le 30 janvier devant 400 personnes. On avait demandé une salle au Teatro Argentina, mais quand on est arrivés, le théâtre était gardé par des rangées de policiers en tenue anti-émeute. » Nous sommes avec Martina Ruggeri, dite Bunny Dakota, conspiratrice-en-cheffe de la teuf romaine, et Leonardo Delogu, performeur et metteur en scène. L’assemblée se tient toutes les semaines dans des squats. De fait, la création contemporaine en Italie se fait beaucoup à l’ombre des institutions. Dans les années 1990 et 2000, c’étaient les centres sociaux et les lieux autogérés. De 2011 à 2014, les artistes romains occupent le Teatro Valle, une expérience horizontale formatrice pour toute une génération dont le modèle est décliné à Milan, Naples et Venise. Il y avait aussi les anciens abattoirs Mattatoio, site de célèbres fêtes queer puis lieu de création transdisciplinaire plus ou moins autonome. En 2021, pendant la pandémie, les occupations de théâtres reprennent : pas d’année blanche en Italie. « Il y a une tradition politique propre aux travailleur·ses de l’art en Italie, particulièrement dans les arts vivants, dont le fil rouge est la précarité : nous n’avons pas de protection sociale et pas de financement pour la recherche contemporaine. » Le seul master d’art performatif pour cette ville de 6 millions d’habitants a été supprimé. « Rome a connu plusieurs expériences excitantes ces dernières années et puis tout a changé très vite. Seule la communauté reste : on est là et on est déters. » C’est cette histoire de la marge qui réunit aujourd’hui le milieu culturel sous la bannière « Vogliamo tutt’altro ». Des assemblées similaires se sont constituées à Bologne, Catane et Cagliari. Un sentiment d’asphyxie politique et financière pousse à la fédération. Et la ville de Rome sait ce qu’elle doit à ces cultures alternatives. La gauche va très probablement perdre les prochaines élections municipales : l’assemblée lui demande de pérenniser des contre-pouvoirs tant que c’est encore possible. « L’idée est de créer un nouveau pôle pour la création contemporaine financé par la Ville et d’en confier la direction à une assemblée générale, démocratique et verticale. Pour l’instant, le maire nous écoute, mais est-ce qu’il aura le courage d’y aller ? » On se permet d’en douter.
Car il se trouve que les contre-pouvoirs existants sont acquis au camp d’en face. Le Théâtre de Rome est noyauté depuis des années par un intrigant syndicat autonome, Libersind, qui cultive des connexions politiques avec la droite la plus extrême. 80 % des employé·es du théâtre, à la technique comme à l’administration, ont désormais adhéré à Libersind : celles et ceux qui ne l’ont pas fait travaillent tous les dimanches. Une récente enquête du journal italien Fanpage.it révélait de très nombreux cas de harcèlement, intimidation physique, sexisme et chantage. Libersind a des méthodes bien particulières dont Martina et Leonardo ont fait les frais lors de la production de leur dernier spectacle. « Tout se passe à l’oral. Il n’y a pas de fiche technique, tu ne sais pas de quels équipements dispose le théâtre. On t’avait promis un système son, et quand tu arrives, on t’explique qu’il n’y en a pas – et on te renvoie vers un loueur privé avec lequel le syndicat a un accord. C’est comme ça qu’ils conservent le contrôle. » Il faut se battre pour obtenir un câble USB et on te fait bien sentir qu’on t’a fait une fleur. Mais toutes les compagnies ne sont pas traitées pareil. Libersind est un organe idéologique. À l’été 2021, le syndicat déclare la grève au Teatro India, la branche plus contemporaine du Théâtre de Rome, reconduite tous les jours à 16 heures de façon à empêcher la représentation du soir. Nous sommes alors en pleine campagne électorale. Sous l’impulsion de la conseillère artistique Francesca Corona, le Teatro India a pris un virage ambitieux et expérimental ces dernières années, si bien que Giorgia Meloni l’a dans le viseur. On l’accuse de s’être transformé en « centre social ». La grève de Libersind va dans le même sens : dans un communiqué, le syndicat explique vouloir défendre la « réputation du théâtre, où l’on propose désormais des rencontres radiophoniques d’un niveau moins qu’amateur, dignes d’un baby-club dans un village-vacances ». Il tient ensuite une conférence de presse et exige que la direction du théâtre soit confiée à Luca De Fusco. Surprise : c’est bien ce même bonhomme qui est nommé trois ans plus tard, en janvier dernier. Francesca Corona jette l’éponge quelques semaines avant la fin de son mandat. Elle dirige aujourd’hui le Festival d’Automne à Paris.

FACHOS PAS FICHÉS
« Le syndicalisme d’extrême-droite est une tradition mineure et très peu étudiée en Italie. Dans les années 1970, ce courant est représenté par le syndicat Cisnal, qui cultive des liens très étroits avec le pouvoir et dont le principe est la collaboration plutôt que l’opposition. Toute la politique de l’extrême-droite sur le travail s’inspire de l’exemple de Cisnal. Pour comprendre comment le fascisme a pénétré la société italienne actuelle, il faut regarder du côté des lieux de travail, institutions publiques comme entreprises privées. Pas par le haut mais par le milieu. » Christian Raimo, intellectuel et enseignant, suit de près les mutations contemporaines du fascisme italien. Pendant des années, au Théâtre de Rome, les agents du « milieu » ont extorqué les directions successives jusqu’à devenir irremplaçables. Les institutions ont laissé faire, ou se sont laissées faire : aujourd’hui, Libersind s’implante un peu partout. Pour Christian, les méthodes et les manières du syndicat relèvent plutôt du piratage du droit syndical que d’une défense du droit du travail. Christian est porte-parole officieux de « Vogliamo tutt’altro » et candidat aux élections européennes sur la liste d’alliance des verts et de la gauche. La liste comprend également Ilaria Salis, une militante antifasciste enfermée dans une prison de Budapest depuis plus d’un an, en attente de son procès. Elle est accusée d’avoir agressé un néonazi lors d’un rassemblement d'extrême-droite européen, interdit – mais toléré – par le gouvernement Orban. Évidemment, l’Italie n’a pas levé le petit doigt pour la faire libérer. Si elle était élue aux européennes, elle pourrait bénéficier de l’immunité. Christian Raimo traverse en ce moment des turbulences similaires : le mois dernier, il disait à la télé qu’« il est juste de frapper des néonazis : nous devons les contrer à tout prix ». Le ministère de l’Éducation a diligenté une enquête sur ses méthodes pédagogiques. Des fascistes cagoulés déploient des banderoles menaçantes sous les fenêtres de sa salle de classe. En Italie, l’antifascisme a longtemps été une boussole morale et politique absolue, sans pudeur excessive sur la réalité violente de la lutte des résistants pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Meloni a du mal avec cette notion. Son gouvernement attaque systématiquement en justice quiconque souligne les racines fascistes du parti, y compris, et même particulièrement, les universitaires, dont ce genre d’analyse est pourtant le métier. Le célèbre historien de la démocratie Luciano Canfora sera jugé en octobre pour diffamation (« néonazie dans l’âme » était sa formule) ; la philosophe Donatella di Cesare, qui avait comparé l’obsession du gouvernement pour le « remplacement ethnique » à une paranoïa « néo-hitlérienne », passera, elle aussi, devant les juges. Le réacteur de cette confiscation sémantique, l’endroit où s’élaborent les étiquettes et les éléments de langage, c’est évidemment la télé. L’extrême-droite a pénétré la RAI par le haut et par le milieu : la majorité des dirigeants sont acquis à sa cause et Libersind s’y implante progressivement. Le 25 avril dernier, anniversaire de la Libération, l’intervention de l’écrivain antifasciste Antonio Scurati est annulée à la dernière minute pour « raisons éditoriales ». Des cas de censure et d’interférence se multiplient ; plusieurs journalistes et présentateurs vedettes ont quitté le groupe, et pas seulement des gauchistes patentés. Ça tourne au grotesque. « Il y a quelques semaines, on a eu droit à un débat sur l’avortement avec sept hommes sur le plateau. Quand tu demandes à la RAI pourquoi ils font des choses pareilles, ils te répondent : “On avait invité trois femmes mais elles ne pouvaient pas venir !” », raconte la journaliste Lisa di Giuseppe, qui suit les tribulations de l’audiovisuel public pour le quotidien Domani. Fin avril, l’émission Report diffusait une enquête sur les centres de rétention administratifs en cours de construction en Albanie, mais gérés par l’Italie, et destinés à enfermer des demandeurs d’asile arrêtés sur les côtes italiennes. « Edi Rama, le Premier ministre albanais et grand allié de Meloni, a appelé le responsable des investigations de la RAI sur son téléphone personnel pour l’engueuler. Personne n’a voulu me dire comment Edi Rama avait obtenu ce numéro, mais ils n’ont pas tant d’amis en commun que ça. » Meloni rêve d’une sorte d’internationale « no border » entre régimes autoritaires : Orban tu prends les antifascistes, Rama tu t’occupes des migrants, et si besoin je vous file la zapette.
DU BIEN-FONDÉ DES DIVIDENDES
Mais l’élément le plus préoccupant est peut-être encore ailleurs : un certain nombre de cadres de la RAI, qui aujourd’hui chantent les louanges de Meloni, étaient en poste avant même son élection. On doit leur nomination à Dario Franceschini, figure du Parti Démocrate et ministre de la Culture de 2014 à 2022. De même, c’est une réforme de 2015 portée par Matteo Renzi qui renforce le poids du gouvernement dans les nominations du conseil d’administration de la RAI. « La gauche avait saboté la liberté de la presse, l’indépendance du cinéma et les institutions démocratiques bien avant Meloni », déplore Francesca Manieri, scénariste de nombreux films à succès public et critique, dont ceux de Luca Guadagnino et Jasmine Trinca, et réalisatrice de la série Supersex. « Quand elle est arrivée au pouvoir, elle a dû se dire : “Le boulot est déjà fait ? Formidable !” » Toutes les mauvaises séries patriotiques que la RAI nous a servies cette année étaient en production avant 2022. Le gouvernement se contente de distribuer des primes : la réforme du crédit d’impôt prévoit, pour l’année prochaine, un financement ad hoc de 53 millions d’euros pour des fictions sur les « grandes figures italiennes », à l’image de la série de la RAI sur Guglielmo Marconi, inventeur des communications sans fil au début du XXe siècle et grand soutien du fascisme, évidemment.
Pourtant, malgré tout, le cinéma italien se porte plutôt bien. Ses films sont très représentés dans les festivals internationaux. Les studios de Cinecittà, rapatriés dans le domaine public il y a quelques années, ont retrouvé leur niveau d’activité des années 1960, et cinq nouveaux plateaux de tournage sont dans les tuyaux. Les trois postes clés de la production narrative – RAI Fiction, RAI Cinema et Cinecittà – sont occupés par l’extrême- droite, la présidente de cette dernière étant également à la tête de l’Association des Producteurs de l’Audiovisuel (APA). Le gouvernement a bien pondu quelques mesures de protectionnisme symbolique, mais globalement, il n’en a pas besoin : le marché joue sa partition. « Les producteurs ont intériorisé les exigences du nouveau régime : ils ont compris ce que l’on attend d’eux et ils orientent leurs contenus en fonction de ça, analyse la journaliste Lisa Di Giuseppe. Ça tourne beaucoup autour de la guerre, des patriotes, de l’État libre de Fiume – une série d’épisodes historiques chers aux nationalistes recyclés à l’infini dans la fiction. » Depuis 2022, le monde des arts vivants et certains milieux intellectuels ont été contraints, par manque de recours, à radicaliser leur opposition. Les grands noms du cinéma, à quelques exceptions près, sont complètement aphones. Ils parlent en aphorismes et en allégories. Ils ne disent rien qui fâche. Tout le monde veut garder la face et protéger sa mise. Francesca Manieri est bien consciente du piège : « Le monde du cinéma est un marécage, un lac plein de merde, dans lequel il est très difficile de se mouvoir. Les gens ont peur de perdre leur place dans le carré d’or. On veut de l’argent, on veut garder nos privilèges, on est corrompus par le pouvoir. Dans les années 1950, les néoréalistes étaient amis dans la vie et encartés au Parti Communiste, ce qui leur permettait d’être dissidents. Aujourd’hui, il n’y a pas de “vague” ou de “scène”, et assez peu de solidarité. »
Depuis 2022, Giorgia Meloni a fait beaucoup de bruit autour des théâtres, des opéras et des musées d’art contemporain. Elle en a assez peu dit sur le cinéma, avançant ses pions discrètement et pariant, à raison, sur la docilité du milieu. Or la création audiovisuelle est le vrai vecteur de l’hégémonie culturelle. Cinecittà et le Centre Expérimental de Cinéma sont des inventions mussoliniennes ; dans les années 1930, la Mostra de Venise récompensait les films de propagande allemands et italiens. Sur le fronton de l’école de cinéma, Mussolini avait fait graver cette phrase de Lénine : « Le cinéma est l’arme la plus forte. » Dans La marche sur Rome, un documentaire de 2022 narré par Alba Rohrwacher, le réalisateur Mark Cousins détricote plan par plan le film A Noi (1922), qui relate la prise de Rome par les chemises noires, pour montrer comment l’histoire s’écrit au montage, aux effets de caméra. En France, la suppression de la redevance audiovisuelle et la fusion annoncée de Radio France et France Télévisions semble préparer le pays à un destin similaire – et nous savons que quand l’Italie saute dans un panier de crabes, la France n’est pas loin derrière. Une nouvelle salve de nominations à la RAI et à Cinecittà est prévue juste après les élections européennes de juin : les cadres installés par la gauche qui ont su négocier le virage postfasciste pourront garder leur place ; les autres seront remplacés par de meilleurs soldats. Un pourrissement « par le milieu » encouragé par le haut, une histoire d’amour consentie entre le capitalisme créatif et le grand récit national, avec en bout de chaîne des treillis à la télé matin et soir. Remettez-nous les Télétubbies.
Texte : Emile Poivet
Photographie : Jean Kader, pour Mouvement
Lire aussi
-
Chargement...