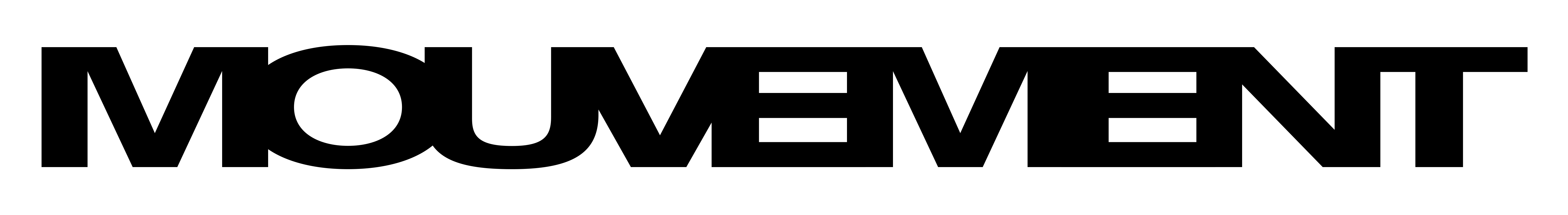Par des développements rigoureux menés sur Powerpoint, le cycle de spectacles-conférences Atlas de l’anthropocène traite des sujets aussi surprenants que l’histoire d’une famille de lapins sur l'île de Kerguelen, le goût des moustiques-tigres pour les aires d’autoroute ou la rancune de la morue. Est-ce que tout est vrai ?
Oui ! Si ce n’était pas vrai, ça ne m’intéresserait pas. Je pars toujours d’une question à laquelle j’essaie de répondre en présentant un argumentaire nourri uniquement d’éléments scientifiques, mais dont les agencements prennent des libertés avec la déontologie scientifique. Je traite mes sujets sérieusement, mais je ne m’adresse pas à trois doctorants. Je cherche à ce que les gens puissent me suivre dans mon raisonnement même s’ils ignorent tout du sujet ou qu’ils n’ont pas fait d’études. De fait, je n’ai pas d’obligation vis-à-vis de mes pairs, ce qui me permet de créer des raccourcis ou de faire des choix qui vont nourrir le décalage que je cherche à mettre en jeu. Un scientifique ne va pas se poser la question d’une histoire d’amour unilatérale entre l’humain et le moustique. En pratique, je suis confronté à un moustique qui a absolument besoin de nous piquer, sinon il ne peut pas faire des œufs et se perpétuer en tant qu’espèce. J’invite donc à voir la piqûre comme une chose nécessaire à la biodiversité, même si c’est désagréable et que personne n’aime ça. En construisant mon argumentaire plus librement, j’arrive à l’expression de sentiments et de sensibilités qui peuvent nous mettre en empathie avec un phénomène ou une espèce.
Comment déterminez-vous les sujets de vos spectacles-performances ?
C’est le territoire qui impose son sujet. Dans le cas de la morue, j’étais parti à Saint-Pierre-et-Miquelon pour tout autre chose. Je voulais enquêter sur les limites du plateau continental, qui sont des frontières contestées entre la France et le Canada, et qui font l’objet d’une requête de l’ONU. Sur place, je suis tombé malade et j’ai dû prendre un bateau pour rentrer à Saint-Pierre. À bord, je rencontre le commandant qui s’avère être l’un des porte-parole de la révolte des pêcheurs dans le cadre du conflit qui les opposait à la métropole sur la gestion des stocks de morues. C’était le plus grand espace marin du monde de pêche à la morue pendant des siècles. Aujourd’hui, elle n’est plus pêchée, mais ne revient pas pour autant. Là, j’ai ma question et je peux lancer mon enquête. De la même manière, je me suis intéressé au moustique à la suite d’une conférence scientifique à laquelle j’avais assistée. Durant son exposé, l’intervenant nous explique que le moustique progresse très rapidement puisqu’il « prend l’autoroute ». Je n’y croyais pas, je l’ai questionné et j’ai voulu aller vérifier sur le terrain. Les Déterritorialisations du vecteur rend compte de cette enquête.
Avant de vous tourner vers le théâtre, vous avez enseigné la géographie. Comment cette première formation impacte votre démarche artistique ?
La démarche des géographes consiste à tenter, à partir de la pensée d’un lieu spécifique, d’en faire ressortir les caractéristiques. Or, des vers de terre dans son sol jusqu’à la planète qui le porte, ce lieu est pris dans de multiples agencements et imbrications d’échelles. Tout ça crée une richesse à démêler, un hors-sujet permanent qui est en fait le sujet. Pour moi, ce « attention hors sujet » contre lequel on nous mettait en garde à l’école est précisément ce qu’il nous faut faire aujourd’hui pour penser le monde. J’ai aussi gardé un goût pour le terrain. Ça me parait difficile de parler d’un glacier au Groenland sans aller sur un glacier au Groenland, à moins de manquer la dimension sensible, qui elle-même produit tout un tas de nouvelles questions. C’est en cela que je reste géographe : j’ai envie d’aller vérifier sur place si ce que j’ai vu ou imaginé est vrai.
Les textes de vos conférences-spectacles ne sont pas écrits. Pourquoi ?
Prenons l’exemple des leçons inaugurales au Collège de France. Très souvent, le texte est écrit et l’orateur le lit avec grand brio et tout l’auditoire est pris dedans. Mais ça reste une écriture textuelle, parfois difficile à suivre. L'oralité me permet d’avoir un rapport immédiat et plus souple à ma narration de manière à l’adapter, rebondir à un regard de spectateur ou préciser un point parce que je sens que je n’ai pas été clair. L’oralité, l’adaptabilité, la rapidité d’élocution imposée par le support Powerpoint, le format d’une heure me semblent appropriés pour aborder l’anthropocène. Même si nous nous devons de ralentir notre rapport au monde, la dégradation en cours et les points limites chaque jour atteints exigent de nous une réponse rapide.
De la morue de Fréderic Ferrer
⇢ du 10 octobre au 12 octobre à Points communs, Cergy