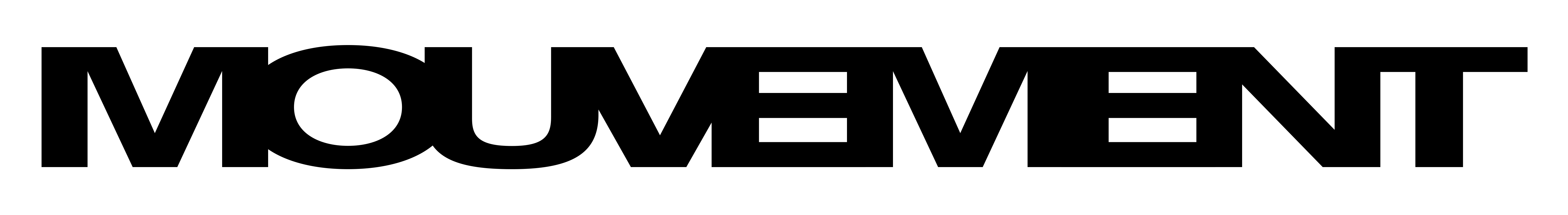Pour Iannis Xenakis, les rafales de flashs et de lasers qui électrisent les Polytopes rappelaient celles qui striaient le ciel pendant la guerre civile en Grèce en 1946, où il combat et se blesse gravement. Comment investir un dispositif chargé d’un tel sens ?
Chloé Thévenin : Xenakis occupe une telle place dans l’histoire de la musique qu’il a fallu trouver comment se positionner au sein de son œuvre. S’inspirer des intentions de l’artiste ? Ou trouver les sensations que je voulais éprouver au sein de son installation ? D’autres pièces commandées par l’IRCAM pour le Polytope sont bruitistes, plus dans l’esprit des masses sonores du compositeur. J’ai voulu m’accaparer le Polytope différemment. Par exemple en y glissant un peu d’harmonie, de mélodie, sans tout miser sur l’écriture. Le compositeur américain d’avant-garde John Cage procédait souvent ainsi : tout n’était pas écrit. Chez Xenakis, au contraire, les formes sont très écrites. Je me situe quelque part entre les deux. Dans le dispositif du Polytope, visionnaire pour l’époque, les sons pénètrent le corps, jouent sur l’esprit. Visuellement, c’est un jeu de lumière et non pas d’images : cela laisse libre cours à l’imagination. J’ai choisi de jouer sur des polyrythmiques, d’embarquer le spectateur pas à pas, de prendre des libertés par rapport à la synchronisation son/lumières. À l’arrivée, je propose davantage un rituel collectif chamanique que je ne présente une œuvre. C’est un moment suspendu.
Immersion dans le son, jeu de lumières, dialogue avec le corps, rituel collectif : on retrouve là les ingrédients du clubbing. Après trois décennies derrière les platines, y prenez-vous toujours autant de plaisir ?
CT : Oui, toujours. Mais il faut dire que j’ai le luxe de pouvoir refuser des bookings qui ne me conviennent pas. Parce qu’une bonne soirée, ce n’est pas que de la musique. C’est une communication bien faite, qui attirera un public en particulier. C’est une sécurité sensible aux questions de sexisme et à la communauté LGBT+. Les musiques électroniques correspondent à toute une mouvance, à toute une culture, qui m’importent. Tous ces aspects comptaient à l’époque du Pulp [club historique sur le boulevard Poissonnière à Paris, où Chloé et une partie de la scène électro française ont fait leur début, ndlr] et, pourtant, ceux-ci n’étaient pas encore définis. Aujourd’hui, les nommer – « safe space », « queer », etc. –, c’est les affirmer davantage.
Concernant la scène, d’abord : elle s’est incroyablement élargie. Avant, on se connaissait tous. Maintenant, je peux jouer dans des cadres où je ne connais personne, même à Paris. Je découvre d’autres réseaux, d’autres collectifs et ça me plait. Ensuite, le club est devenu un business. On en pâtit tous à une certaine échelle – même si, encore une fois, j’ai la chance de n’être invitée à jouer que dans des contextes qui me correspondent. Il y a vingt, trente ans, l’artistique primait. Aujourd’hui, certains festivals, certains clubs, bookent les artistes parce qu’ils cartonnent sur les réseaux sociaux, qu’importe ce qu’ils jouent sur place. La communication a pris le pas, alors que, longtemps, le secteur s’est revendiqué « anti-com ». Heureusement, aujourd’hui, mon activité se partage entre le DJing et la production – de mes propres projets ou de musiques de films. Je ne m’imaginerai plus ne faire que du club, même si j’adore ça.
Polytopes 2025 du studio ExperiensS avec les bandes sons de Chloé, /nu/thing et 665.99, du 6 au 14 juin dans le cadre du festival Manifeste de l’IRCAM au CENTQUATRE
Lire aussi
-
Chargement...