Un portfolio extrait du Mouvement n°118
À Las Vegas, Nice ou Ouarzazate, Harry Gruyaert, né à Anvers il y a 82 ans, photographie des lieux intermédiaires où le temps et les gens ne font que passer. Rencontre dans son atelier parisien plein de machines dernier cri, alors que le BAL ressort ses premiers cibachromes.
 |  |
Il fait un temps de chien ce matin-là, et Harry Gruyaert ne s’en plaint pas. Elle est nécessaire, cette pluie qui tambourine aux fenêtres aveugles de son atelier, un petit rez-de-chaussée sur rue à deux pas du Génie de la Bastille. Le bruit blanc des gouttes s’accorde aux airs tristes joués par Tuur Florizoone tandis que défilent, sur un iPad bancal près d’un café brûlant, 160 instantanés des Hauts-de-France. Dernier opus de la série de diaporamas « A Sense of place », Nord enchaîne des vues variées : la gare de Lille, l’usine Sollac à Dunkerque, la plage de Berck. Reflets, fumées, marée basse. Archives ou actualités, ces décors proches des films de Bruno Dumont mettent dans l’ambiance Ch’ti. Donner l’impression est l’unique intention de Harry Gruyaert. « J’ai un problème avec les gens qui pensent trop. Pour moi, le concept n’existe pas », marmonne-t-il, affalé sur un lit de camp en chemise, pantalon de velours et chaussons vénitiens, bleu en haut et pourpre en bas, chaussettes comprises.

Dernier opus de la série de diaporamas « No ideas but in things » écrit l’Américain William Carlos Williams dans Paterson, poème épique qui dresse en cinqtomes, de 1946 à 1958, le portrait éclaté de la cité ouvrière du même nom, au nord du New Jersey, là où coule et chute la rivière Passaic. Si la formule sert de titre à l’exposition du BAL qui réunit 80 early works balayant deux décennies et neuf pays, c’est qu’elle épouse le style direct de Gruyaert, attaché au concret, à la raison simple, aux preuves irréfutables que chaque lieu est unique en son genre : sa lumière, sa nature, son architecture, son esprit, toutes ces choses qui ne s’expliquent pas et pourtant se vérifient. En attestent, sur la table, les tirages de lecture de Marseille vue du tram, réponse à la vaste commande de la BnF de 2021, sorte de « radioscopie de la France » post-crise sanitaire. Des jeunes attendent leur rame dans le soleil couchant, et la mer se perçoit, bien qu’on ne la voie pas, comme la violence dont la rumeur monte à peine. Incomplet, le vers de Carlos Williams est plus à propos dans sa totalité : « A man is indeed a city, and for the poet there are no ideas but in things. » Gruyaert rêve aussi et il est, en effet, pareil à une ville étrangère. Il faut fouiller son passé de déplacé pour le comprendre. Évadé d’Anvers où il grandit et étouffe, deuxième d’une famille de six enfants catholique à outrance, il mettra du temps à savoir où il habite. Attiré par la mode, les filles, la folle vie facile des sixties, il atterrit à Paris et fraye avec les photographes William Klein, « très rentrededans », Jeanloup Sieff, « très européen ». « C’est fou comme ils ressemblent à leurs photos ! » s’étonne alors l’aspirant assistant, qui cesse aussitôt de vouloir imiter ses modèles. Avant que la remarque ne vaille pour lui, que ses images ne soient, à son image, subtiles, secrètes et romantiques, Peter Knapp le traite de « petit Saul Leiter » et l’emploie au magazine Elle, entre deux tournages pour la télévision flamande. En 1969, mandaté par les croisières Paquet, il s’aventure au Maroc, pays chaud où tout – les gens, l’environnement, les éléments – entre en « fusion ». Sur cette terre de contrastes, synthèse entre « le Moyen Âge et Brueghel », le complice de Gordon Matta-Clark reviendra à répétition, séduit par ces ombres drapées qui rasent les murs, semblables aux paquets de Christo. Jamais rompu, le charme opère dans un nouveau livre, annoncé pour l’automne prochain, suite du best-seller Maroc paru en 2013 chez Textuel. D’autres voyages, moins exotiques qu’initiatiques, l’attendent : l’Inde en 1976, l’Égypte en 1987… « À l’époque, quand on traversait les frontières, tout était différent : les gens, les vêtements, la nourriture, les bâtiments. »
 |  |
D’Ostende à Calcutta, de Philadelphie à Essaouira, sa manière reste égale. Cette constance à l’épreuve d’une géographie variable le distingue de William Eggleston, autre apôtre de la couleur : le natif du Mississippi ne joue bien qu’à domicile. « La plupart des photographes américains ont produit un travail formidable aux États-Unis et très moyen en dehors. Friedlander, que j’adore, a été plusieurs fois en Inde sans jamais ramener une photo intéressante. Ils sont tellement marqués par leur territoire qu’ils ne sont bons que sur place. » Parti ailleurs, Gruyaert rentre chez lui pour revisiter le plat pays, la relation amour-haine qui les lie. Prendre ses distances lui a servi : « Quand tu restes trop longtemps au même endroit, tu finis par penser que tout y est normal. Or, en Belgique, rien n’est normal. » En 1973, il y entame une « thérapie », d’abord en noir et blanc, parce que tout lui semble gris. « Jusqu’à ce que je m’intéresse à la banalité », précise le fan de pop art, qu’il a découvert à New York en 1968, l’année où sa soeur aînée, missionnaire au Zaïre, trouve la mort. « La Belgique est probablement le pays européen qui s’est le plus vite américanisé après la guerre, d’où la puissance de cette banalité, confrontée au surréalisme et à la force des traditions conservées malgré tout. Beau, laid, banalité du beau, beauté de la laideur. Ces contradictions sont aussi les miennes », confiait-il dans Made in Belgium, publié en 2000 chez Delpire. En misant sur l’ordinaire, sa photographie prend des couleurs, se déride : « Je suis beaucoup plus sarcastique en Belgique. On se moque plus facilement de sa propre culture. Et puis, c’est le pays qui veut ça » ironise-t-il, citant l’humour de Magritte, le sarcasme d’Ensor. La peinture sérieuse de Jacob van Ruisdael, paysagiste du siècle d’or hollandais, pleine de dunes, de forêts, de ciels d’orage, l’influence autant. Ce double héritage, entre rigueur et dérision, le poursuit.
À Londres, en 1972, Gruyaert devient cynique. Planté devant un « téléviseur fou » dont il bidouille les réglages, il capture tout ce qui passe à l’écran : les JO de Munich, un soap opera, la mission Apollo 13, un concours canin… « C’est sans doute mon travail le plus journalistique », hasarde Gruyaert à propos de ces TV Shots acides, zapping psychédélique et chronique prophétique du lavage de cerveau qui menace déjà la société du spectacle. Le « reporter en chambre », qui intègre pourtant Magnum Photos en 1981, dix ans avant Martin Parr, ne récidivera pas, rétif aux réflexes de ses pairs « qui pensent en doubles pages ». Après deux années d’errance dans le combi Volkswagen contre lequel il avait troqué sa Mini Moke de photographe de mode, l’agence lui offre un cadre, l’amour – Agnès Sire, fraîchement recrutée par l’équipe de Paris –, une seconde famille. « J’aurais pu rentrer chez Viva, mais c’était trop français, et je n’ai jamais aimé les discussions à n’en plus finir. Je ne suis pas intellectuel pour deux sous. Moi je fais, un point c’est tout. » Faire, au commencement, c’est marcher seul et vite, ouvert à l’inconnu mais détaché, affranchi : « Dès que tu rentres quelque part, tu as du mal à en sortir. Dans la rue, je suis libre. Je ne suis pas un photographe de l’intimité. » Shooter le met dans un état d’excitation proche de la transe. « C’est une sorte de danse, un plaisir physique lié à la chasse, à la pêche. Quelque chose m’attire et réciproquement. » Capturer l’objet de son désir suppose un effacement digne de Cartier-Bresson, dont il admirait la capacité à se « couler près des gens ». Discret, Harry Gruyaert porte des lunettes et mate en cachette. « Je suis un voyeur », avoue ce grand timide gêné par les visages, hormis ceux de ses filles Saskia et Marieke, scrutés en noir et blanc de la naissance à l’adolescence. Très construites, ses images graphiques n’en restent pas moins volées, furtives, presque mobiles. Parfois, le regard ne sait plus où se poser. La hiérarchie entre le centre et la périphérie s’y inverse volontiers, juxtaposant des motifs disparates, « comme dans les collages de Picasso ». Gruyaert parvient toujours à ordonner le chaos, à se repérer dans les espaces saturés de signes. La couleur le guide. « C’est un moyen de sculpter ce que je vois, une valeur en soi », affirme celui qui, faute de pellicules Kodachrome, interprète pendant des heures ses tirages numériques avec Albin Millot, son bras droit, pour restituer fidèlement un clair-obscur, un certain jaune, l’émotion de la scène. Ce qui importe dans les plans fixes de ce cinéaste manqué, hanté par ceux d’Antonioni, c’est l’atmosphère d’ensemble. Le climat plutôt que la pure vérité. Un air de mystère flotte dans ces arrêts sur images que Richard Nonas disait « marqués du sceau de l’irrésolution ». Chacun se suffit. Les rapprochements s’opèrent a posteriori, variations sur un même thème, une même destination – les rivages, les seuils, les aéroports, Moscou – et ces sommes produisent, à défaut d’un film, un effet, une onde, une rime. Avoir connu la solitude et l’isolement est nécessaire pour entendre l’écho, partager cette vision du monde déphasée et amortie. Celle d’un nouvel arrivant permanent, à disposition – et fatalement à l’écart – de ce qui l’entoure.
 | 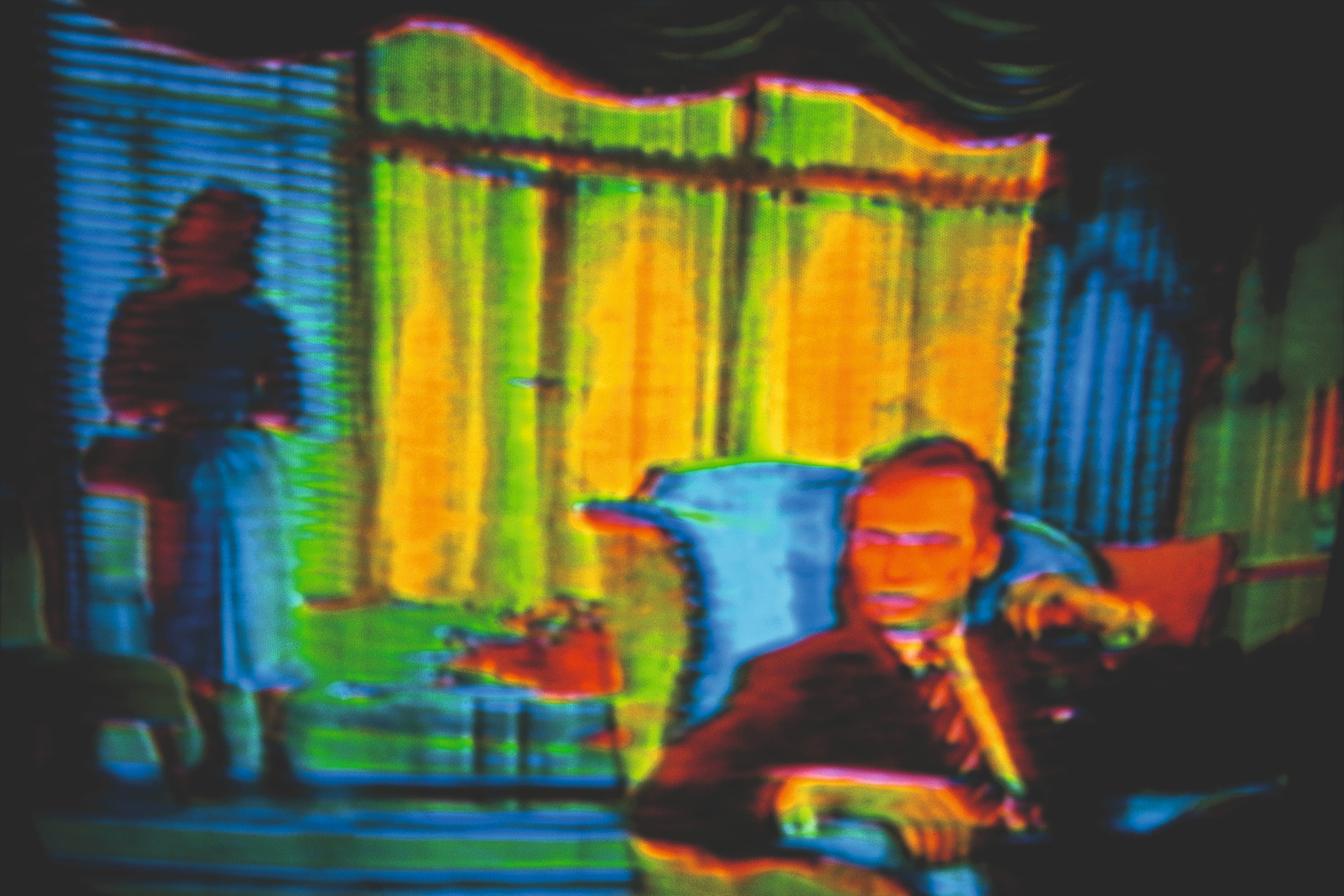 |
 |  |
 |  |
> L'exposition La part des choses d'Harry Gruyaert, jusqu'au 24 septembre au BAL, Paris
Texte : Virginie Huet
Lire aussi
-
Chargement...






