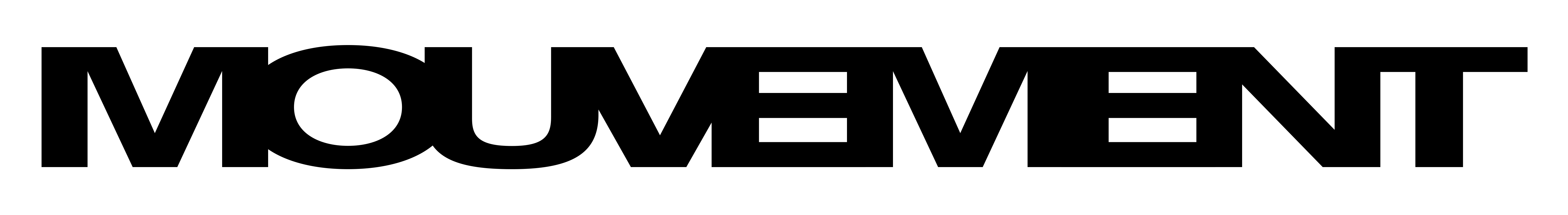Vivre dans un pays où l’homosexualité a été décriminalisée ne protège pas de bafouiller au moment de décrire ses premiers émois amoureux et l’éveil de désirs minoritaires. Pour les ressortissants d’États où aimer peut encore être un crime, un tel récit, arraché par une administration à l’affût de fausses notes, relève de la gageure. Comment verbaliser un amour tenu jusque-là caché ? C’est pourtant ce que demande l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) aux personnes qui lui formulent, au terme d’un parcours déjà long, une demande d’asile.
Dans un parc, un portique et un rideau ont été dressés. L'espace théâtral qu’ils suggèrent est celui de ces salles sans charme où s’active une bureaucratie zélée. Lors de son entretien, une demandeuse d’asile doit convaincre l’officière de protection de l’OFPRA de son attirance pour les femmes et des dangers encourus dans le pays quitté. Sans préambule, les questions fusent et, entre elles, quelques réponses tentent de se frayer un chemin, dans une passe d’armes tendue qui finit par ressembler, au gré d’une chorégraphie complexe et saccadée, aux tentatives de viol répétées d’une intimité.
Sophie Billon et Nangaline Gomis, seules en piste, accomplissent une prouesse. Elles parviennent, presque sans pause et bien qu’en extérieur, à projeter avec une grande clarté un texte dense tout en se livrant à d’intenses séries de gestes et de figures athlétiques, désynchronisées de leurs répliques, ensemble ou en contrepoint, jusqu’à susciter le vertige. Chacune paraît agir dans la précipitation pour tenir un rôle imposé par une entité sadique.
C'est que cette performance gesticulée correspond à une réalité administrative qui tient elle-même du théâtre. À l’OFPRA, la crédibilité des récits est jugée selon des critères si subjectifs que des assos se sont spécialisées dans la préparation à l’exercice. Ayant aidé à les mettre en scène dans le cadre de l’une d’elles, Nicolas Barry signe un texte où prévaut l’indignation face à la violence étatique. D’où sans doute la transfiguration de Sophie Billon en une SuperKaren horripilante de mesquinerie. Face à elle, Nangaline Gomis, malgré la difficulté de la chorégraphie, oppose le visage calme d’une dignité éprouvée mais qui ne cède pas – si l’on excepte ces rires muets et ces grimaces qui échappent au duo face au racisme qui s’invite, ou pour purger l’absurde d’une farce orchestrée en haut lieu.
Tour de force du dispositif, nous supportons plus facilement cette Nurse Ratched – version rageuse et bureaucratique – parce que nous la voyons s’épuiser en même temps que la femme qu’elle harcèle. L’agacement laisse alors place à l’admiration devant l’exigence des rôles. Comme pour en décrasser ses interprètes, la fin du spectacle les fait d'ailleurs littéralement changer de pièce : les voici chez Phèdre et Racine, où tout s’apaise. On comprend alors que la joute oratoire qui vient d’avoir lieu a beaucoup à voir avec les procédés du théâtre classique français.
Il n’est pas si fréquent qu’on puisse dire d’un spectacle qu’il est plus que malin, qu’il est intelligent. Nicolas Barry aurait pu se borner à représenter cette scène d’une bureaucratie ordinaire en s’en tenant à la métaphore où s’arrêtent généralement les spectacles dansés, et au clin d’œil rapide à Kafka. Mais c'est en prenant le risque de tout verbaliser, en déroulant les ficelles de deux performances enchâssées, que l’honnêteté explicative du texte finit par nous faire sourire : la performativité exigée par la procédure de l’OFPRA, à laquelle tout nous renvoie, fait déjà spectacle par elle-même.
Si le propos fait écho aux analyses de l’anthropologue Didier Fassin sur l’économie morale – la tension entre compassion et surveillance – ainsi qu’aux régimes de véridiction – tels que nommés par Foucault – qui sous-tendent les protocoles de l’OFPRA, la forme du spectacle poursuit un projet personnel. Dans sa pièce Le rêve de voler, que Nicolas Barry interprétait lui-même, notre culture du dépassement de soi – tout aussi artificielle – était gentiment moquée. À chaque fois, la référence assumée est l’idiotie comme l’entend le philosophe Clément Rosset : derrière une apparence naïve, une méthode incisive de décorticage du réel ; et, malgré le millefeuille de sens, des spectacles accessibles à tous les publics.
Dans La demande d’asile, en dénonçant le carcan de la mise en récit et la duplicité institutionnelle, l’idiotie version Nicolas Barry finit par s’approcher – plus subtilement qu’il n’y paraît – d’une expérience nue et de l’émotion retrouvée.
La demande d’asile de Nicolas Barry a été présentée le 16 août dans le cadre du festival Far° à Nyon, Suisse
⇢ le 28 novembre à l’Espace culturel An Dour Meur, Plestin-les-Grèves
Lire aussi
-
Chargement...