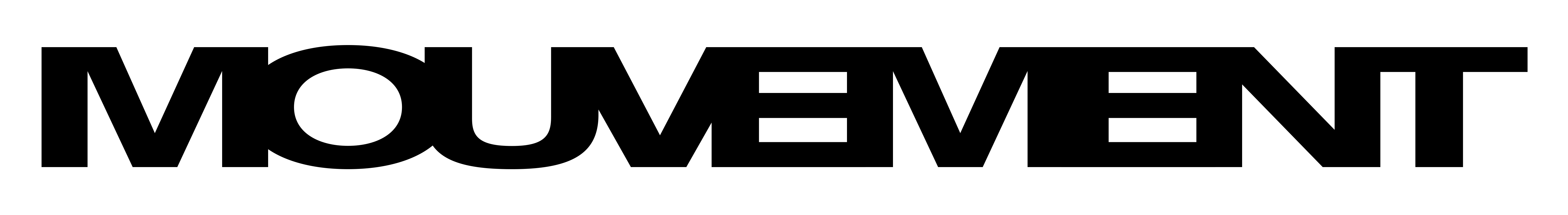Quels souvenirs gardez-vous de votre formation à ces formes traditionnelles ?
C’était au sein d'El Qantara, une association de quartier à Bourges, toujours en activité. J’avais huit ans et mes parents cherchaient surtout à m’occuper pour éviter que je traîne dans la rue. Nous vivions dans un HLM du quartier Nord de la ville. Enfant, je rêvais d’être footballeur. Après l’école, je me rendais à contre-cœur au suivi scolaire de l'association puis aux cours de musique et de danse. J’ai commencé à 12 ans la musique arabo-andalouse par le chant et le luth arabe, appelé “Kwitra”. J’ai suivi ces cours sur une quinzaine d’années et donné des concerts dans ce cadre. Pour nous, c’était avant tout une occasion de sortir de notre quartier et de voyager en France. Nous ne réalisions pas la richesse d’un tel enseignement. Hélas, au fil de ma formation de danseur (au CNDC d’Angers) et une fois lancé professionnellement, j’ai abandonné cet héritage.
Comment a eu lieu la reconnexion ?
En tant qu’interprète, inconsciemment, j’ai gardé un lien fort. Mais le vrai déclic a eu lieu en 2015 en jouant dans D’après une histoire vraie de Christian Rizzo. J’y dansais un court solo qui comprenait des mouvements traditionnels du Maghreb et je me suis dit que c'était le moment de revenir aux sources. L’envie est devenue viscérale jusqu’à constituer une ligne dans mes recherches chorégraphiques. En 2018, mon solo Pulse(s) revisitait des danses traditionnelles du Maghreb, masculines comme féminines. Il ne s’agissait pas simplement de les reproduire, mais de comprendre leur origine et leur influence sur le danseur contemporain que je suis.
Gouâl a été travaillé à partir de l’allaoui, danse de guerre dans la tradition maghrébine, initialement réservée aux hommes. Quels en sont les enjeux et les caractéristiques ?
L’allaoui est généralement pratiquée dans la région du Rif (nord-est du Maroc et nord-ouest de l'Algérie) et s’accompagne musicalement avec des instruments artisanaux. Elle trouve ses origines dans les danses tribales des hauts-plateaux oranais. Ce type de danse était interprétée par les guerriers avant et après les combats, en groupe homogène, en ligne ou en cercle, avec des mouvements frénétiques d’épaules et des coups répétés du pied. On en voit encore en Algérie lors de manifestations festives. Ce qui m’attire dans cette forme, c’est qu’il s’agit d’une composition rythmique instantanée, menée par le leader du groupe et suivie par les musiciens. La danse part de cette base.
Comment avez-vous partagé cette danse avec votre équipe ?
Je leur ai transmis les gestes et l’histoire puis leur ai montré des vidéos que j’ai tournées à Sidi Bel Abbes pendant la fête de l'Indépendance du pays. L’espace dédié à cette danse a sa propre scénographie : le public se place tout autour, sur trois niveaux selon les générations. Au premier rang, les personnes âgées sont assises au sol, derrière, les adultes en bonne santé sont debout, leurs enfants sur les épaules. La version in situ de Gouâl reproduit d’ailleurs ce dispositif circulaire.
Quelle relecture faite vous de cette danse ?
Je me suis appuyé sur sa complexité rythmique, sa géométrie dans l’espace et ses répétitions. J’ai travaillé avec trois femmes et trois hommes, en les mélangeant délibérément. J’ai mis en avant la physicalité de cette danse sans son support musical pour en extraire l'essentiel : solidarité du groupe, unité du mouvement et conscience spatiale. En travaillant la répétition dans la durée, le corps finit par se concentrer sur l'essentiel du mouvement et se met en transe.
> Goual de Filipe Lourenço, le 17 juin au Centre Chorégraphique National de Tours dans le cadre du festival Tours d'Horizon
Lire aussi
-
Chargement...