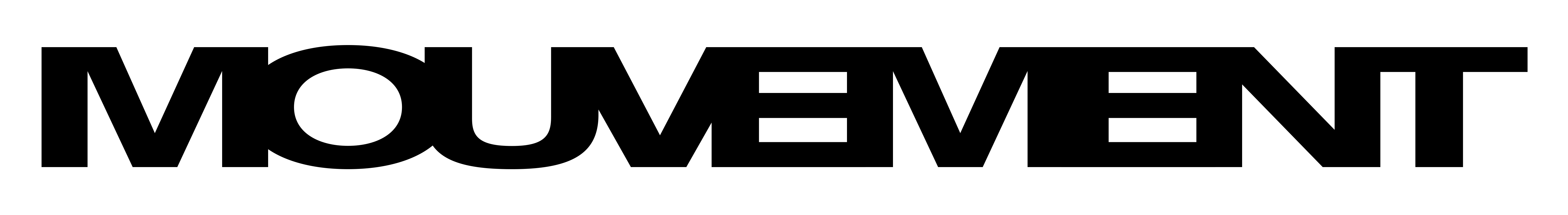Lorsqu’on l’avait interviewée une première fois en juillet 2020 au sujet de Si le vent tombe, la réalisatrice Nora Martirosyan, malgré le contexte sanitaire délétère, apparaissait radieuse. Après avoir figuré conjointement – une première – dans la Sélection officielle et dans celle de l’ACID (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion) au Festival de Cannes, son film commençait à être projeté dans les festivals, avant sa sortie en salle fixée au 18 novembre. L’aboutissement de dix années de travail pour tenter de traduire la teneur fictionnelle d’un lieu réel, mais sans existence politique officielle : le Haut-Karabagh, république autoproclamée depuis 1991, située à la limite de l’Arménie – qui n’en a jamais reconnu officiellement l’existence –et de son éternelle rivale, la république d’Azerbaïdjan.
Entre-temps, le drame – la réalité la plus violente – est venu soudainement dépasser la fiction. Fin septembre 2020 en effet, le cessez-le-feu décrit dans Si le vent tombe fut brutalement rompu : l’opération « Poing d’acier » menée par les Azéris contre l’Arménie, et conclue par un cessez-le-feu le 10 novembre, s’est soldée par la reconquête de la majeure partie des territoires perdus lors du conflit de 1991. La ville de Stépanakert, capitale du Haut-Karabagh où se passe la plus grande partie du film de Nora Martirosyan, était en grande partie détruite, et sa population, déplacée. Lorsqu’on l’avait revue alors, la réalisatrice nous était apparue bouleversée, en proie à la douleur et à la colère.
Aujourd’hui, Si le vent tombe sort enfin sur les écrans. Ce film qu’avant le tournage, elle dépeignait malicieusement à son directeur de casting comme un mélange de Jacques Tati et d’Abbas Kiarostami, et avec lequel elle avait souhaité donner la mesure d’un territoire quasiment jamais montré à l’écran jusqu’à présent, est devenu un objet différent. Malgré elle, la fiction a été rejointe par le documentaire, faisant du film un témoignage unique sur un pays qui auparavant n’existait pas, et qui aujourd’hui n’existe plus. Et auquel le monde ne fait, selon elle, toujours pas attention.
Juillet 2020
Quel a été le déclencheur de Si le vent tombe ? Était-ce une image, une scène, un visage… ?
« Le point de départ, c’est mon premier voyage au Haut-Karabagh, en 2009. J’ai découvert un territoire qui n’existe pas au plan juridique et géopolitique, mais qui pourtant est bien là, avec une capitale, un président, une constitution. Cela m’a paru fou, extraordinaire ! J’ai vécu une expérience d’un lieu très, très forte, quelque chose qui, intellectuellement et émotionnellement, a été d’une très grande importance. Donc il ne s’agissait pas pour moi de faire un film, mais de faire un film là-bas.
« Ce lieu possédait en lui-même une telle force de fiction que je pensais qu’un film documentaire ne parviendrait pas à transmettre l’envol que cet endroit proposait. Le film se base simplement sur le fait qu’un pays existe, invisible sur les cartes, peuplé par des Arméniens du Karabagh, où la guerre peut recommencer à n’importe quel moment – comme cela manque de se produire à un moment dans le film.
Quand avez-vous commencé à travailler sur le film ?
« Tout de suite après ce voyage, sauf que je ne savais pas encore que j’étais en train de travailler sur un film. Je n’avais qu’une idée extrêmement vague, et pas forcément réaliste, de ce que représentait le processus de fabrication d’un film. Lorsqu’en 2011, j’ai découvert cet aéroport où les gens viennent travailler quotidiennement sans que des avions y atterrissent ou en décollent, j’ai su que celu-ci deviendrait le centre du film. Cet aéroport sans avion symbolise la situation du Karabagh, ce mélange d’absurdité et d’espoir – parce que les gens continuent de croire que l’aéroport va fonctionner et les relier au monde, dont ils sont coupés géographiquement. Mais il m’a fallu du temps pour comprendre que les choses étaient beaucoup plus complexes que cette « réalité » géopolitique, et que cette histoire d’aéroport tient de la propagande autant que de la croyance ancestrale…
« Quand on parle d’un film de « fiction », on sous-entend souvent qu’il y a une « intrigue » : une crise familiale, une histoire d’amour… Pour moi, la fiction, ce n’est pas ça. La fiction, c’est quand le monde est transformé par des ressources insoupçonnées ; faire de la fiction, c’est transformer le monde, ce n’est pas faire une pâle copie du réel. Dans Si le vent tombe, il n’y a pas d’« action » parce que toute l’action est déjà à l’intérieur : on n’a besoin de rien pour faire avancer les choses, l’histoire est déjà là.
Vous avez collaboré avec l’écrivaine Emmanuelle Pagano : à quel moment est-elle arrivée dans le projet, et qu’y a-t-elle apporté selon vous ?
« Le scénario a connu peut-être quinze versions différentes. Après avoir essayé de travailler avec des scénaristes de cinéma, je suis revenue vers Emmanuelle, avec qui j’avais déjà parlé de mon projet en 2013, lorsque nous étions toutes deux pensionnaires à la Villa Médicis. Au départ, il s’agissait seulement de voir si nous étions capables de travailler ensemble… et ça a fonctionné. Emmanuelle m’a aidée à rester fidèle à moi-même et m’a interdit de glisser vers quelque chose censé plaire au public.
Comment s’est passée votre collaboration avec Grégoire Colin, dont le personnage arrive à Stepanakert pour mener un audit de l’aéroport en vue de sa réouverture ?
« Lorsque je l’ai rencontré, je cherchais un acteur pour interpréter un rôle, et j’ai un rencontré un être humain qui me semblait être capable de vivre quelque chose, quelque chose que j’allais pouvoir filmer. Le rôle de Grégoire est à la fois très simple et très complexe : tout ce qu’il a besoin de faire, c’est de regarder cet endroit. Là était le pari : jouer un personnage qui prend l’empreinte de tout ce qui se passe autour de lui, qui possède suffisamment de porosité pour que ça rentre en lui sans devenir à aucun moment démonstratif. Il ne s’agissait pas d’appliquer un rôle sur un comédien, mais de chercher, avec l’être humain qu’est Grégoire, le personnage d’Alain. Et ce, jusqu’à changer les dernières scènes du scénario, afin de les rendre plus justes par rapport à ce qu’on avait vécu.
En préparant le film, aviez-vous en tête des partis pris d’écriture, de réalisation, voire des références ?
« Ce territoire, comme l’Arménie d’où je viens, est très particulier parce qu’il est rempli de contrastes, de paradoxes : il est au croisement de l’Occident et de l’Orient, avec en plus 70 ans de régime soviétique. C’est une région très inspirante. Mes références cinématographiques viennent du cinéma iranien ou géorgien, et évidemment du grand cinéma soviétique, dont toute notre génération a été nourrie.
« Pour moi, profondément, le cinéma sert à raconter des espaces qu’on n’aurait jamais vu de cette manière-là, et qu’on n’aurait jamais rencontrés si le cinéma n’existait pas. Ainsi, jamais le film ne montre le folklore du Karabagh, et quelqu’un qui irait y passer une semaine en touriste ne retrouverait rien dans mon film de ce qu’il aura vu. Je pense que le film contient autant de surprises pour les gens du Karabagh ou d’Arménie que pour les spectateurs français car il leur montre un Karabagh qu’ils n’ont jamais vus : c’est le cinéma qui leur fait découvrir ce territoire-là. Par les choix de cadrage, de montage et de temporalité, le film essaie de traduire ma propre expérience du lieu.
Certains ont situé votre film à l’intersection des deux grands cinéastes arméniens que sont Artavazd Pelechian et Sergueï Paradjanov – au confluent du réel et du fantastique…
« Je suis mal placée pour vous répondre, mais ce sont bien sûr mes deux influences majeures. Pelechian, par son art du montage absolument extraordinaire, fait de la poésie à partir du réel. Ses films (je pense à Nous par exemple) n’ont rien de documentaire. Rien n’est mis en scène, c’est du réel, sauf que la façon dont il le raconte n’a rien de réelle. Paradjanov, c’est l’inverse : à partir de quelque chose de complètement faux et fantaisiste, il invente une sorte de réel, de folklore qui n’existe que dans sa tête, mais il le fait avec un tel aplomb que celui-ci devient une réalité. Beaucoup de gens imaginent que l’Arménie ressemble à un film de Paradjanov…
Au vu de votre parcours, passé par la Rijksakademie d’Amsterdam et par Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, vous risquez d’être présentée comme « une plasticienne venue au cinéma » : est-ce une fausse question ?
« C’est une question complexe… Quand j’ai décidé de parler du Karabagh, il était très clair que le résultat serait un film, et un film de fiction. Il m’a fallu dix ans pour parvenir à faire cet objet-là. Je pense que toutes les formes – qu’elles soient destinées à l’espace de la galerie ou aux salles de cinéma – sont opérantes pour moi à partir du moment où j’y trouve cette flamme que j’ai eue pendant que je tournais.
« Avec Si le vent tombe, j’ai fait l’expérience de la durée. Pour arriver à tenir pendant un mois et demi sans lâcher, en continuant à se poser des questions, en arrivant chaque matin sur le plateau avec l’envie, la joie et la peur, pour garder ça, il faut vraiment être un coureur de longue distance. Il faut être toujours branché sur la bonne fréquence, et toujours revenir à cette question essentielle : pourquoi est-ce que je fais ça ? Chaque soir, quand je n’en pouvais plus, je sortais marcher dans les rues de Stepanakert, à travers la brise, et je me reposais mentalement la question : pourquoi suis-je en train de faire ce que je fais, et pourquoi est-ce moi qui dois le faire ? C’est une sorte de double responsabilité.

Octobre 2020
Depuis que nous nous sommes parlé en juillet, et la reprise des hostilités entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, qu’est-il advenu des êtres et des lieux que l’on voit dans votre film ?
« Le 26 septembre avait lieu la première parisienne du film : la projection était très émouvante, parce que l’équipe du film et beaucoup de mes amis y assistaient. Lorsque le 27 septembre, au réveil, on a appris la reprise des actions militaires, c’était la sidération. Moi qui vivais avec mon film, j’étais soudain rattrapée par la réalité la plus laide : la réalité militaire. Quand je lis et regarde les informations aujourd’hui, je suis terrifiée de voir combien le réel – le réel de ces actualités – est tellement plus cruel que ce que j’aurais pu imaginer dans la fiction, et dépasse toutes mes inventions les plus osées. C’est très troublant.
Vous qui disiez ne pas avoir voulu faire un film politique, si vous deviez laisser parler votre fibre optique, comment analyseriez-vous la situation actuelle ?
« Mon film tente de raconter les espoirs des femmes et des hommes vivant sur leur terre et espérant la paix pour leurs enfants. Si l’on croit à la dignité de ces personnages, à leur intégrité, à leur droit de vivre en paix, cela peut traduire ma position politique, et celle-ci n’a pas varié : j’ai essayé de décrire un Haut-Karabagh paisible peuplé par les Arméniens. Dans le film, le chauffeur dit : « Cela ne sert à rien d’avoir des terres si tu ne les cultives pas. » La population du Haut-Karabagh cultive ces terres parce qu’elle l’a toujours fait, elle y a toujours enterré ses morts. C’est donc quelque chose qui a du sens…
« Après, l’Arménie a toujours été à cheval entre l’Asie et l’Europe, et a subi de plein fouet toutes les invasions successives ; c’est un pays qui en prend plein la gueule depuis toujours, et qui va continuer à en prendre plein la gueule. Sachant que dans un monde où c’est l’argent qui règne, le pays qui possède le gaz et le pétrole a davantage d’arguments…
Juste avant sa sortie, votre film devient tout à coup un objet différent…
« Aujourd’hui, dans les échanges avec le public qui suivent les projections, je ne peux plus parler comme si de rien n’était. En un sens, le film y perd sa légèreté, les gens n’osent plus rire aux moments drôles. Il devient un objet dramatique, ce qui n’avait pas été prévu – mon propos était plutôt d’inspirer l’espoir – et un objet documentaire, une archive sur ce qu’était le Haut-Karabagh entre deux guerres… Je suis encore en train d’apprendre comment en parler sans abîmer ni le film, ni surtout cette douleur que tous les Arméniens ressentent de jour en jour.
« J’espère simplement avoir suffisamment su capter la dignité de mes personnages pour que le public qui a vu le film et qui lit les actualités comprenne que derrières les chiffres des blessés et des morts, il y a ces gens-là, ces enfants-là, que ce sont ces villes et ces villages qui sont aujourd’hui pris dans la tourmente. Ce à quoi on assiste aujourd’hui, c’est à une tentative d’effacer, par tous les moyens, trente ans de paix, de création, de culture, et ce, dans l’indifférence générale. J’avais fait mon film parce que je pensais qu’il était important que le monde voie cet endroit, qui est complexe, qui est beau, qui est fort, qui propulse une idée de fiction complètement dingue. C’était le cessez-le-feu, et le monde ne le regardait pas. Aujourd’hui, après cette nouvelle guerre, le monde n’y fait toujours pas attention. »
Propos recueillis par David Sanson
> Si le vent tombe de Nora Martirosyan, sortie en salles le 26 mai
Lire aussi
-
Chargement...