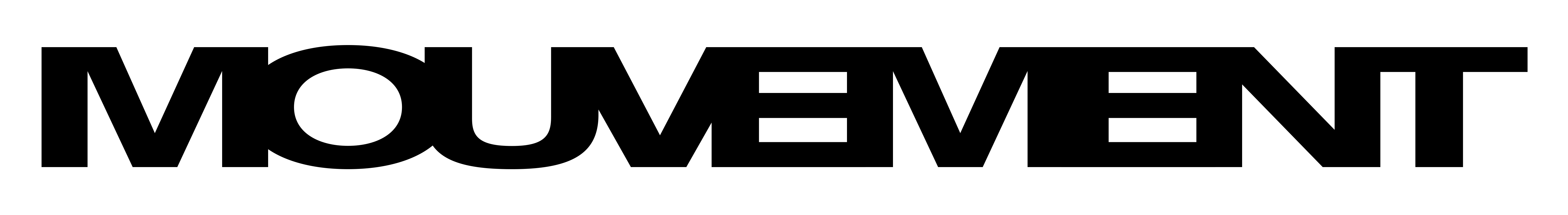Le dérèglement climatique est un enjeu mondial et transgénérationnel. Pour construire une réponse adaptée, l’économiste Cédric Durand pioche dans tous les répertoires de l’action politique : réformisme, fédéralisme et social-réalisme. Il propose une planification à grande échelle, assistée par des algorithmes et contraignante pour le marché. Une « utopie institutionnelle », en somme.
Un entretien extrait du n°126 de Mouvement
Pour que nos sociétés occidentales se montrent à la hauteur des urgences écologiques, la voie de la planification politique vous semble la meilleure. Pourquoi ?
La planification s’oppose à deux autres options. La première est celle du « tout marché ». On attacherait un prix à la biodiversité en chiffrant sa destruction ainsi que les services qu’elle rend « gratuitement », pour la faire entrer dans des calculs économiques, via un système de taxe par exemple. Le problème, c’est qu’en autorisant une logique de compensation – autoriser la pollution d’une rivière contre la plantation d’arbres – la rationalité de marché tend à tout mélanger, alors que la nature ne fonctionne pas ainsi. L’autre option serait celle de l’hyper-localisme : régler le problème écologique à petite échelle. Or nous sommes tous pris dans une socialisation et une division du travail dont il est difficile de sortir. Si vous souhaitez vous passer de voiture et habiter dans une petite communauté autonome du fin fond de l’Ardèche, votre vélo dépendra toujours du métal produit dans les pays du Sud global. Sortir de ce système est ardu pour certains, impossible pour d’autres : si vous vivez dans un grand ensemble, vous dépendez vitalement de ces interconnexions. Dans un cas comme dans l’autre, en sortir se ferait au prix d’un appauvrissement considérable. La troisième option est celle de la planification. Elle n’est pas parfaite, mais elle permet, dans une certaine mesure, d’agir de façon rationnelle et à l’échelle de l’humanité.
En quoi la planification est-elle un processus non seulement technique mais aussi politique ?
Pour se restreindre et se fixer des objectifs, une comptabilité écologique est nécessaire. Je pense, avec d’autres, que celle-ci doit prendre la forme d’un « inventaire permanent de la nature » même s’il restera incomplet. Les connaissances scientifiques permettent d’évaluer l’espace écologique dévolu aux activités humaines pour que celui-ci s’encastre dans les limites planétaires. Mais ce processus est aussi politique : la planification est ce moment où l’on passe de la contrainte à la modélisation de scénarios possibles – quant à nos types de développement et de modes de vies en société. Puis, vient la phase de délibération collective sur le plan à adopter. Quels besoins satisfaire et jusqu’où ? Quels volumes de consommation allouer à tel ou tel domaine ? Quelle place donner à tel mode de transport ou d’habitat ? Faut-il un scénario très numérique, ou moins numérique ? Tels sont les choix que doivent résumer les différents plans. Mais pour qu’ils ne restent pas des mots en l’air, il faut des leviers d’actions. Et le plus important d’entre eux est une forme de contrôle public sur l’investissement.
La notion de « transition » est à la mode. Pourquoi lui préférer celle de « bifurcation » ?
Avec mon coauteur Razmig Keucheyan nous tenons à insister sur le fait qu’il ne s’agit pas seulement de verdir les processus existants. Avoir des voitures électriques à la place des voitures thermiques ou remplacer les passoires énergétiques par des habitations plus économes sont des avancées importantes. Mais l’enjeu de la bifurcation va plus loin : il s’agit de restructurer nos sociétés et nos modes de vie dans le but de rééquilibrer notre rapport à la biosphère dans son ensemble. Dans ce cadre, il va falloir par exemple réinventer collectivement le voyage. Quel espace accorder au transport aérien ? Faudrait-il que certaines classes d’âge seulement soient autorisées à voyager en avion ? Faudrait-il autoriser ces trajets uniquement dans le cadre de longs séjours à l’étranger ? Cette bifurcation ne doit pas être construite uniquement comme une contrainte. Faire la même chose en vert, c’est peut-être la faire en plus propre, mais c’est aussi la faire en moins bien. Avec la bifurcation, il y a la volonté de changer la dimension qualitative de nos expériences, de provoquer des effets positifs sur notre bien-être, de nous libérer de certaines insatisfactions propres aux modes de consommation et de production actuels.
Comment s’assurer que cette bifurcation reste démocratique et ne soit pas confisquée par un pouvoir technocratique ?
Une manière de s’en assurer est de favoriser la diversité des modes de délibération. Pour modéliser les scénarios, le modèle des assemblées citoyennes semble pertinent : choisis pour être à l’image de la société, les membres de ces comités travailleraient sur le temps long pour s’approprier des connaissances. Ensuite, une démocratie représentative plus classique pourrait prendre le relais : des députés élus feraient le choix parmi les différents scénarios imaginés. On pourrait aussi imaginer des moments de démocratie directe avec des référendums. En ce qui concerne la mise en œuvre, nous sommes en faveur d’un dispositif fédéral. Les grandes orientations seraient définies au niveau central mais déclinées localement, en fonction des contextes et des acteurs économiques. Je vois deux avantages à cela. S’organiser localement renforce l’appropriation démocratique et favorise l’expérimentation et l’innovation. On s’assure par là de ne pas développer des monocultures techniques. C’est moins efficace à court terme – parce qu’on ne choisit pas tout de suite la meilleure option – mais en diversifiant les solutions, on est plus à même de s’adapter. Et donc d’être résilients, au sens fort.
Le rôle que devraient jouer les technologies numériques dans cette planification est encore sujet à débat. Pourquoi aurions-nous tort, selon vous, de nous en passer ?
Je ne nie pas l’impact désastreux du numérique sur l’écologie. Il faut une sobriété numérique, au même titre que dans la mobilité, l’habillement, l’alimentation, etc. Pourquoi est-ce néanmoins souhaitable de disposer de ces outils ? Parce que la planification est, fondamentalement, une question de mobilisation des connaissances. Et si on veut être capable, en tant qu’humanité, de faire des choix collectifs informés, il serait dommage de s'en priver alors que ceux-ci nous permettent de compiler et d'analyser des données, de produire des modèles pour continuer à apprendre sur notre rapport aux écosystèmes et de prendre conscience des différentes dimensions de la destruction écologique. Aujourd’hui, les dispositifs d’observation satellitaires sont indispensables pour mesurer les destructions de la biodiversité en complément des observations de terrain.
Seulement, ces technologies ne sont pas neutres : elles sont au service des intérêts des Big Tech.
Les technologies du numérique, telles qu’elles ont été développées, ne visent pas à l’efficacité, mais d’abord au maintien du pouvoir et des profits de ceux qui les déploient. Elles sont devenues tellement centrales dans la division du travail qu’elles sont en train de transformer les conditions économiques et politiques d’existence de nos sociétés, nous menant vers un point de régression, dans un système que j’ai appelé le techno-féodalisme. Mais encore une fois, aussi aliénante soit cette socialisation dont nous héritons, en sortir n’est pas désirable. Se passer de ces technologies – si tant est que ce soit possible puisque nous en sommes aujourd’hui dépendants – impliquerait d’en créer d’autres et donc de repartir, sinon de zéro, du moins de très loin. La démarche que nous développons est celle des utopies institutionnelles : partir de ce qui existe, ou a existé par le passé, et essayer de recombiner pour faire face aux échéances du moment. La transformation ne peut se faire, selon nous, qu’en partant de l’existant.
Comment pourrions-nous nous réapproprier ces technologies ?
Ces technologies sont constamment reproduites par l’investissement. Cette question peut avoir l’air technique, mais c’est le nerf de la guerre. L’investissement est le monopole dont disposent les capitalistes pour définir les modes de développement. Socialiser l’investissement serait donc un moyen de reprendre le contrôle. Si on taxait les profits de manière très importante, les entreprises devraient se tourner vers les banques et s’endetter pour continuer à investir. Elles ne pourraient alors le faire qu’en respectant les critères du modèle de développement choisi démocratiquement. En ce qui concerne plus spécifiquement les Big Tech, trois logiques peuvent être développées. Premièrement, créer des infrastructures publiques. Aujourd’hui, les clouds, les câbles et les satellites sont privés, alors qu’ils étaient publics jusqu’en 2010. Deuxièmement, constituer les données comme des communs. Il n’y a pas de raison que Google se les approprie alors que celles-ci sont le fruit de notre activité sociale, pour la simple raison que la multinationale est en mesure de les capter. Qu’elle les utilise, très bien, mais sans monopole : les autres – les citoyens, les pouvoirs publics, les entreprises intéressées – doivent, dans certaines conditions, y avoir accès. On peut faire tellement de choses avec ces données. Troisièmement, mettre fin à l’économie de rente des Big Tech. Aujourd’hui, si vous créez une application, les plateformes qui les commercialisent, comme Apple Store ou Web Service, captent une part importante de vos revenus et s’approprient les connaissances générées par votre outil. L’activité numérique favorise la création de nouveaux types de services et il faudrait pouvoir laisser vivre cette activité entrepreneuriale, mais dans le cadre de places de marché publiques protégeant véritablement l’innovation.
Selon vous, la nécessité de cette bifurcation est sur le point de s’imposer dans les esprits. Face à l’actualité, il est difficile d’y croire.
Nous sommes dans un moment réactionnaire. Trump en est la caricature et les extrêmes droites freinent des quatre fers partout dans le monde. Mais pas au point de nier l’importance des enjeux écologiques à l’échelle planétaire. Depuis les années 1970, toute une machinerie institutionnelle a été mise en place, qui fait que la conversation mondiale – du moins au sein de l’élite – reste dominée par cette question. De plus, personne n’échappe au capitalocène et à ses effets. Trump peut rester dans le déni, mais les ouragans sont de plus en plus nombreux et dévastateurs aux États-Unis. Et cela coûte cher aux assureurs, qui sont bien obligés de prendre en compte cette réalité dans leurs calculs. D’autre part, et bien qu’elle soit en tension avec les besoins de développement, l’écologie reste centrale dans le Sud global. Enfin, la compétitivité – au sens brut du terme – se joue aujourd’hui au niveau des modes de production les plus propres possibles. Tout est sur les rails pour que l’entreprise chinoise de véhicules électriques BYD devienne le leader de la filière automobile dans les dix ans à venir. Du point de vue industriel, la Chine est la success story de la transition écologique. C'est insuffisant – le processus ne va pas assez loin, ni assez vite, et s’inscrit toujours dans un cadre capitaliste – mais le pays dépasse ses objectifs. Si cela ne suffit pas à lutter contre l’anthropocène, les trois éléments que je viens de citer, combinés, laissent à penser que les discours négationnistes ne pourront pas s’imposer sur le temps long.
Propos recueillis par Aïnhoa Jean-Calmettes
Photographie : Matthieu Croizier, pour Mouvement
■ Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète ?, Éditions Amsterdam, 2025
■ Comment bifurquer, avec Razmig Keucheyan, Éditions La Découverte, 2024
■ Techno-féodalisme : Critique de l’économie numérique, Éditions La Découverte, 2020
Lire aussi
-
Chargement...