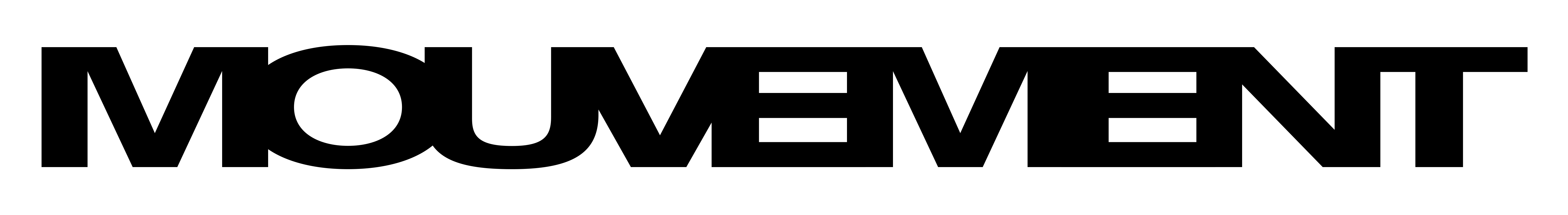[½uvre]Comme Du Griot au Slameur l’an dernier, ce projet Du Slam à l’Atlas articule polyculturalité et oralité autour du concept de parole rythmique. Que représente pour vous cette parole rythmique et en quoi pareil projet est-il pertinent ?
Frédéric Deval : « Depuis l’expérience Le Rythme de la parole, il y a quelques années avec Keyvan Chemirani, l’une de nos hypothèses de travail est, dans une recherche des universaux culturels, que la parole rythmique est une constante d’une majorité de cultures, et que cet élément structurant du langage – un mot utilisé pour sa sonorité et sa pulsation récurrente – peut donner lieu, même à notre époque de mondialisation, à un dialogue entre des individus issus de cultures différentes : griots maliens, slameurs français et marocains, rwâyés berbères, compositeurs et improvisateurs européens… Cette grande dame du chant berbère de l’Atlas qu’est Raissa Fatima Tabaamrant n’avait l’an dernier jamais entendu Khalid Moukdar, ni même du slam marocain, et vice versa. Quant à Khalid Moukdar, il ne connaissait rien du slam de Dgiz. Et pourtant, le dialogue a eu lieu.
Dans Du Slam à l’Atlas, la parole rythmique est ainsi le personnage central, invisible, autour duquel s’organise une rencontre d’égal à égal et se créent des liens, des points d’entrée d’un langage à l’autre. Elle joue le rôle de passeur entre Marocains de cultures différentes et entre cultures marocaines et françaises. Il y a là multitude de fils, qu’il s’agit de tisser pour créer une trame.
La parole rythmique devient donc un langage commun, que tout le monde s’approprie ?
Andy Emler : « C’est le but : chacun contribue à ce langage commun. Chacun nous amène sa parole, que nous allons devoir nous approprier. Non pas la mettre à notre sauce, mais la travailler à notre tour, avec nos propres outils. Le saxophoniste explorera le jeu du rebab marocain ou le batteur de jazz essaiera de jouer de la percussion marocaine sur sa batterie, sans plaquer son savoir ni tenter une simple imitation. Et inversement.
En quoi cette démarche se distingue-t-elle de celle de la « fusion », dont les exemples sont si nombreux depuis plus de vingt ans ?
A.E. : « Notre propos n’est pas de faire un b½uf, ce qu’on a déjà entendu des millions de fois, mais davantage de créer la rencontre, entre tradition arabe, tradition berbère, slam français et marocain, entre les genres et les styles.
On prend donc des slameurs français et marocains, des musiciens marocains et berbères apportant chacun leurs bagages de thèmes traditionnels – des musiques monodiques, avec des jeux de questions/réponses entre voix et instruments – et un quintette de jazz. A partir de ce matériau d’une richesse incroyable, nous élaborons ensemble un discours cohérent dans lequel chacun aura sa place. C'est une démarche beaucoup plus rare. Si, dans les premiers temps, ce que nous faisions s'apparentait à de la fusion, les univers musicaux se sont bientôt interpénétrés de manière bien plus profonde, créant un système musical neuf. Nous ne nous contentons pas de jouer sur des modes, nous composons. Nous voulons tous nous approprier les langages de chacun au sein d'une composition plus vaste. Et nous devons nous-mêmes nous y habituer, faire nôtre ce système inouï, ce qui n’est pas non plus habituel.
Comment organise-t-on cette rencontre ?
A.E. : « Ce sont des mois de travail, qui commencent en octobre 2009, avec un premier voyage au Maroc pour rencontrer les artistes et s’imprégner de leurs personnalités et de leurs musiques. Puis une première résidence, fin mai-début juin 2010, qui s’est assez bien passée, même si le travail a été lent. On a eu besoin de temps, et j’avoue que les musiciens européens ont plus facilement pénétré l’univers des musiques marocaines que l’inverse.
Ce n’est qu’à la deuxième résidence que nous avons réussi à les amener à des choses qui ne sont pas dans leurs habitudes, pour obtenir une unité d’orchestre, un son cohérent global, avec, comme référence constante, la parole rythmique, le slam, le chant. Ce n’était pas encore l’idéal espéré, mais on s’en approchait.
F.D. : « Un jour, Andy Emler a essayé de leur faire travailler un rythme en tapant dans les mains, pensant qu’un quart d’heure serait suffisant pour que chacun le maîtrise : trois quarts d’heure plus tard, ils y étaient toujours ! Petit décalage, grands effets. Car c’est là qu’apparaît l’écart entre les cultures. La pensée musicale et la pensée rythmique sont fortement liées au contexte historique de leur création ainsi que de leur performance originelle. En guise d’exemple, Mehdi Nassouline, extraordinaire polyinstrumentiste marocain, qui a un pied dans toutes les traditions musicales marocaines, disait ainsi à Andy : “ Le premier temps chez toi, c’est le troisième chez moi ! ”
Pour revenir à l’hypothèse sur la parole rythmique, cette différence entre les pensées rythmiques peut-elle trouver son origine dans le langage lui-même ? A la scansion propre de chaque langue ?
A.E. : « Chacun voit le rythme à sa façon. Khalid (qui chante essentiellement en arabe marocain) et Dgiz en ont des visions très différentes, sans qu’aucune ne soit plus ouverte que les autres.
F.D. : « Chacun a son flot, son débit, les rythmes et les mesures dont il est familier, une aptitude plus ou moins grande à les changer.
En quoi consistaient les incompréhensions et les « résistances » de la part des musiciens en présence ?
A.E. : « Au début, Raïssa Fatima Tabaamrant ne voulait pas improviser à la voix, en duo avec le piano – et pourtant ça s’est bien passé ensuite. Mais elle a ses textes et ses chansons, et ne voyait pas bien où je voulais en venir. Il y a là un aspect qui dépasse le musical, celui de la rencontre, de la confiance. Le deuxième ou le troisième jour, j’ai essayé autre chose : plutôt que d’accompagner harmoniquement au piano, j’ai imité un instrument de percussion avec les graves de mon piano, pour rester dans un contexte sonore plus ou moins afro-maghrébin. Mise à l’aise, elle a commencé à chanter. Comme j’ai une bonne oreille, je me suis mis à suivre ses notes, comme un balafon africain, puis à harmoniser son chant. Enfin, j’ai repris son chant au clavier, en lui ajoutant une dimension harmonique à l’européenne, mais en jouant du piano comme on jouerait sur un sitar, par exemple – même si je n’ai pas de quart de ton, je peux préserver l’esprit modal de cette musique. Jouer du piano à l’occidentale n’a, dans ce contexte, aucun intérêt ; cela ne produit que de la variété, et pas forcément la meilleure. Ce n’est que le cinquième jour qu’elle m’a avouer comprendre.
F.D. : « Il faut définir la zone de recouvrement, qui rend possible une invention commune. Raïssa est une femme dont on baise la main dans les rues d’Agadir et dans les villages de l’Atlas. Elle délivre une parole sibylline, indirecte, quasi prophétique dans ses allures ; ce sont des aphorismes, parlés ou chantés, sentences, critiques sociales ou morales très poétiques, miroirs de la société. Elle est “ ce que dit la bouche d’ombre ”, pour reprendre Victor Hugo et n’est certes pas habituée au duo.
A.E. : « Les Marocains ne comprenaient d’ailleurs pas pourquoi on entendait ces thèmes à ce moment-là, alors qu’on les rejouait plus tard. La dimension formelle de la chose – comprenant réexpositions, transpositions, variations rythmiques sur un élément de thème – leur était étrangère, de même que sa dimension verticale – eux qui sont davantage habitués au monodique. On a dû réexpliquer plusieurs fois que ce n’était justement pas un morceau, mais que je voulais établir un lien, une cohérence dans le déroulement de la soirée, du premier au dernier souffle – ils ont plus l’habitude de la fusion, où l’on enchaîne indifféremment des morceaux indépendants les uns des autres.
Qu’est-ce qui distingue ce projet de ceux qui l’ont précédé ? Quels enseignements avez-vous tirés des expériences précédentes ?
F.D. : « C’est la même matrice de Du Griot au Slameur (2008) qu’on a translatée, avec des personnalités et cultures différentes. On constate d’ailleurs, et ce n’est pas un hasard, que quelques personnalités musicales de Du Slam à l’Atlas sont des constantes par rapport à Du Griot au Slameur (Andy Emler, Dgiz, Guillaume Orti ou Taoufik Izeddiou qui fait des impros dansées avec certains musiciens). Mais il y a cette fois une personne qui donne une direction au travail, un véritable directeur artistique : Andy Emler.
Du Griot au Slameur nous avait offert de très grandes réussites, notamment dans les petites formes, mais l’architecture était bancale et, du point de vue des musiciens européens, beaucoup de temps a été perdu dans les prémices du travail, pour se comprendre, et décider d’une direction commune. Il y avait une superbe énergie, des étincelles, qu’un bon directeur musical aurait peut-être mieux su canaliser.
A.E. : « C’était très démocratique, tout le monde avait la liberté de proposer, de disposer, d’imposer. Composer ainsi à plusieurs peut être extrêmement difficile et dangereux. A quinze, c’est presque impossible. Petit à petit, l’architecture (le scénario) s’est mise en place avec les différents éléments qui s’étaient révélés lors des différentes résidences. Finalement, ce n’est que l’urgence de l’échéance qui a fait le tri. Cette année, si le travail reste assez démocratique – chacun est libre de venir proposer –, quand un problème se pose, je tranche en dernier recours.
En quoi cette démarche se distingue-t-elle de celles des compositeurs férus d’ethnomusicologies ?
F.D. : « Quand Bartók intègre des éléments de Transylvanie dans son langage, quand Ohana intègre des éléments de flamenco, l’alchimie de la forme se fait dans le creuset de leur for intérieur. C’est Bartók face à Bartók, Ohana face à Ohana. Quand Royaumont propose ces voyages transculturels, c’est un dialogue entre les musiciens. Pour le projet commun (2007) de Alexandros Markeas et l’ensemble de polyphonies géorgiennes de tradition orale, Anchi Skhati, ce n’est pas le seul Markeas qui fond, comme dans une fonderie de moulage, tous les ingrédients ensemble, c’est un dialogue d’égal à égal entre Markeas et l’entité multiple des douze chanteurs géorgiens. Même si Andy Emler a dans ce projet un rôle de directeur artistique, le dialogue s’instaure entre chacun des artistes en présence. Pour chacun des directeurs musicaux de ces rencontres, l’invention de la forme est un tout autre défi quand on a affaire à un dialogue en chair et en os avec ses musiciens, que lorsqu’on butine des éléments de langage qu’on incorpore à son propre univers, pour les organiser dans une forme qu’on est seul à écrire. Il y a là une dimension collective à la création – qui se répercute jusqu’à la répartition des droits à la SACEM.
A.E. : « De la partition que j’avais préparée en amont du travail et que j’avais amené lors des premières résidences, il reste à peine un tiers : tout le reste a changé au gré des diverses propositions. J’ai jeté beaucoup – parce que les uns ou les autres m’ont proposé des morceaux de leur cru qui correspondaient à la dynamique de la parole rythmique. Ça donne une autre cohérence, différente de celle à laquelle on avait pensée a priori. Je reste totalement ouvert.
F.D. : « C’est une autre des grandes différences par rapport à ce qu’on appelle la tradition écrite européenne. Fixer définitivement, oui, mais après la rencontre, après avoir intégré dans la forme finale les apports de tous les musiciens. Et non la posture du compositeur qui arrive avec son monument, déjà déposé à la SACEM, que le musicien est forcé de jouer en l’état. J’ai entendu Joëlle Léandre dire : “ Il y a eu un jour où j’en ai eu assez d’être l’exécutante de la musique des autres. ” Dans toutes nos expériences, les musiciens ne sont pas de simples exécutants. Même s’ils sont réunis autour d’un directeur musical qui apporte 60% de la musique, ils finissent par s’approprier le matériau qu’ils ont porté ensemble, et auquel ils ont chacun contribué, parfois jusque dans les schémas de construction. C’est un autre rapport à l’architecture musicale, qui déplace radicalement les rapports de l’interprète au compositeur. Ce que nous faisons est innovant aussi en cela, avec toutes les scories et tous les déchets que cela suppose.
A.E. : « Et il est fort probable que la performance du 8 octobre soit différente de celle que l’on fera à Aix-en-Provence en juillet prochain. Plusieurs étapes sont mises en place. La chronologie est à l’opposé de celle suivie par la plupart des créations contemporaines : le compositeur compose. Trois jours avant le concert, les musiciens ont rendez-vous pour la première répétition. Puis, ils montent la pièce et la jouent une, deux ou trois fois. Mais il n’y a pas le temps de remanier. Cela suppose, dans notre cas, une équipe fédérée par une réelle alchimie humaine – qui n’a pas été forcément facile à faire naître.
Andy Emler, vous êtes vous-même, coordinateur du projet, directeur artistique, dans une tradition écrite. Comment la transmission se passe-t-elle ?
A.E. : « Par la transmission orale ! Pour apprendre à notre virtuose du monocorde des thèmes que j’avais amenés, je l’ai pris à part, en face à face, pendant une heure et demie. Cela permet aussi de réajuster et on sait ainsi où on veut aller. Notre saxophoniste suggérait, pour la prochaine résidence, des moments de duo dans le travail, pour que chacun comprenne la pratique de chacune des musiques – et pas uniquement dans le cadre du collectif. Quant à moi, je notais ce qu’ils me proposaient. J’ai relevé pour mémoire tout le travail – pour que tout le monde puisse s’y référer.
Qu’est-ce qu’« écrire » dans ce contexte ?
A.E. : « L’ouverture instrumentale est une espèce de medley, d’offertoire qui réunit presque toutes les thématiques que l’on va utiliser, au moins dans la musique. Les Marocains ne comprenaient d’ailleurs pas pourquoi on entendait ces thèmes à ce moment-là, alors qu’on les rejouait plus tard. La dimension formelle de la chose – comprenant réexpositions, transpositions, variations rythmiques sur un élément de thème – leur était étrangère, de même que sa dimension verticale – eux qui sont davantage habitués au monodique. On a dû réexpliquer plusieurs fois qu’il ne s’agissait pas d’un morceau, mais d’ un lien, d’une cohérence dans le déroulement de la soirée, du premier au dernier souffle. Ils ont davantage l’habitude de la fusion, où l’on enchaîne indifféremment des morceaux indépendants les uns des autres.
La notion de développement d’un matériau thématique qui se transforme et celle de polyphonie seraient donc typiques de la musique occidentale de tradition écrite ?
F.D. : « Elles existent parfois ailleurs, mais je ne pense pas qu’elles entrent alors dans une démarche d’auteur. Si l’on prend l’exemple des polyphonies pygmées Aka, que nous avons découvertes grâce au travail de Simha Arom et qu’a utilisées Ligeti : la succession et la superposition de ces notes est d’une complexité incroyable mais ne relève pas d’une démarche de création de forme. On joue certaines pièces dans certaines circonstances.
Cette démarche d’écriture et d’inscription dans un contexte plus vaste fige-t-elle la musique ? Plaquerait-on une macrostructure (du type « symphonie beethovenienne », par exemple) dans laquelle on insèrerait chaque élément des différentes cultures, chaque proposition et parole rythmiques des divers musiciens ?
A.E. : « Non, car, d’une part, nous préservons certains aspects de transe et de liberté improvisatrice propres à ces musiques, et, d’autre part, le travail de réécriture est constant. Le propos est, simplement, d’apporter une cohérence au déroulement musical. Et de trouver de l’espace pour tous : que chacun soit heureux de faire partie du résultat sonore global et que chacun ait aussi la possibilité de mettre en valeur son art. Si ces deux conditions sont réunies, le plaisir et la réalité de la rencontre (ce n’est pas juste un b½uf), c’est un bon début.
Il y a là un aspect impermanent : quand Bartók écrit, sa pièce peut être interprétée par tous les musiciens qui viennent après lui. Quant aux traditions orales, elles sont pérennisées, au moins en leur c½ur. Dans Du Slam à l’Atlas, l’écriture dépend intrinsèquement de chaque personnalité. Non seulement elle varie d’une soirée à l’autre, par son aspect improvisé et vivant, mais elle est in-reproductible, dès lors que les personnalités en présence varient.
F.D. : « Je l’ai toujours dit, à Royaumont, ce sont des rencontres inter-personnelles. A l’ère de la mondialisation, ralentir la circulation tous azimuts de l’information musicale devient d’autant plus nécessaire, pour privilégier cet espace-temps où la rencontre peut se dilater. C’est intuitu personae. Il y a effectivement quelque chose d’original et d’insubstituable, lié aux personnalités musicales représentées. Au cours du travail, le joueur de rebab a été remplacé et le travail a perdu de son contenu et de sa richesse. Mais c’est peut-être pousser le bouchon un peu loin : à idiome constant, la substitution pourrait se faire, jusque dans le slam – même si Dgiz a une telle virtuosité poétique et rythmique qu’on n’imagine pas un autre slameur français prendre sa place.
A.E. : « Ce serait intéressant d’imaginer Du Slam à l’Atlas avec d’autres musiciens, mais m’étant moi-même tant inspiré pour l’écriture de leurs musiques propres – du chant de Fatima par exemple, si unique dans la tradition berbère – que je ne vois pas très bien comment. Ou alors il faudrait changer une grande partie du travail.
Oralité, polyculturalité et société
Dans le projet, vous articulez également la dualité entre oralités dites traditionnelles et oralité urbaines : mais l’oralité urbaine n’est-elle pas simplement l’oralité traditionnelle transposée ? Le déplacement de la population, de la culture, n’est-il pas justement responsable de la naissance du slam ?
F.D. : « Je ne crois pas. Ou seulement en partie. On veut toujours se sentir pousser des racines sous les pieds. Le fait est que tous ces idiomes se métamorphosent. Bien sûr, on peut entendre la pulsation du rap nord américain dans ce que fait Dgiz, mais sont mêlées également plusieurs influences qui s’étendent de la poésie française, du rap français, au chaabi algérien et marocain. Le produit de la migration, ce sont des idiomes interconnectés.
Lors d’un débat il y a dix ans à Royaumont, Bernard Lortat-Jacob proposait l’hypothèse suivante : plus il y a éloignement, plus il y a perte – l’éloignement considéré étant celui du territoire ethnomusicologique. Selon lui, la migration s’accompagnait immanquablement d’une perte de substance de ces idiomes musicaux d’origine. Je pense au contraire que les migrations déclenchent un grand potentiel de création, dont les références ne sont plus les mêmes. Le bilan entre ce qui a été perdu par rapport à la culture dite d’origine, qui est elle-même le produit d’innombrables interconnexions, et ce qui a été gagné lors du processus de migration/création, est difficile à établir. Mais on ne peut mesurer la valeur ajoutée artistique qu’à l’aune de la communication avec un public. Que transmet-on, lorsqu’on a, certes, un peu perdu de sa culture d’origine, mais qu’on s’est approprié les ingrédients si variés qui pullulent dans la mégalopole Ile-de-France ? La question se pose davantage en termes d’“être ensemble”. L’artiste est-il plus “en phase” avec son public en griot à Bamako, ou en slameur à Bobigny ?
Le slam est-il une tradition orale ?
F.D. : « Pour qu'il y ait tradition, il faut déjà qu'il y ait une certaine épaisseur d'histoire. Une tradition n'est qu'un événement qui se reproduit. On peut dire qu'il y a une tradition du slam depuis le fameux film Slam (1998) de Marc Levin. Une culture est née et s'est transmise depuis quinze ans maintenant. Arrivée en France il y a une dizaine d'années, décalée, translatée, elle s'est ramifiée en de nombreux courants. Venue sur les ailes du rap américain, elle a rencontré le vieux courant de la poésie – littéraire et sonore – française, ainsi que toutes les oralités d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, émigrées en France. Tout ce melting-pot a donné naissance au slam à la française. On peut donc commencer à parler d’une culture, et donc d’une “tradition”. La question de la transmission orale du slam est celle de la frontière entre écriture et improvisation : on a affaire soit à un texte déjà écrit et “performé” oralement sur scène, soit à une improvisation, également “performée” oralement sur scène.
Les oralités anciennes ont toutes plus ou moins trait à la spiritualité ou à une forme de transcendance. Le slam français, beaucoup moins, sinon pas du tout. Comment articulez-vous cette dualité au sein du projet ?
F.D. : « Cette problématique est double. Tout d’abord, on ne peut affirmer que les oralités anciennes, telles qu’elles se présentent aujourd’hui, sont toutes spirituelles. Certains des aphorismes de Raissa Tabaamrant sont liés au religieux, au spirituel, mais de nombreux autres se rapportent davantage à la critique sociale et/ou morale.
D’autre part, on ne peut pas affirmer que les oralités urbaines sont totalement laïques et sécularisées. Même Dgiz est en questionnement sur ce sujet – on l’a vu dans un précédent projet que nous avons fait ensemble, A quel Dieu parles-tu ?, avec Valère Novarina, qui sera repris à l’Odéon, le 19 mars prochain. Simplement, les artistes qui se situent dans les oralités urbaines aujourd’hui – sauf ceux pris dans un fanatisme monothéiste –, n’ont pas de système spirituel préconstruit, transmis par une tradition religieuse institutionnalisée. Si l’on se rapproche du foyer des cultures anciennes, comme celles de l’Inde ou le Vaudou au Bénin, là, la spiritualité prend certes davantage de place, mais il existe entre l’un et l’autre un arc-en-ciel de nuances.
On a parlé d’ethnomusicologie – qu’elle date de l’époque coloniale ou qu’elle soit plus moderne –, mais interrogeons-nous à présent à rebours : du fait de la mondialisation et de la globalisation culturelle et médiatique, les oralités anciennes portent-elles l’empreinte de la présence occidentale ?
F.D. : « Sans avoir une vision globale, j’aurais deux ou trois éléments de réponse, qui remontent aussi à l’année du Maroc, programme que j’ai mené à Royaumont en 1999. Tout d’abord, parlons du cas d’Ahmed Essyad qui serait davantage un contre-exemple. Né en 1939, ce Marocain a décidé de venir étudier la musique en France, après avoir écouté les Suites de Bach à seize ans. Puis, ce fut son passage auprès de Max Deutsch, des postsériels, le développement d’une écriture personnelle, l’écriture d’opéras, de commandes à Radio France… Voilà quelqu’un qui a été touché par l’esprit de la composition européenne et qui n’a cessé d’essayer de faire la jonction avec la musique qu’il entendait chez lui – musique arabo-andalouse, musique berbère de l’Atlas. C’est un contre-exemple resté unique et, d’ailleurs, relativement ignoré dans son pays : les grandes formes de la composition européennes sont extrêmement peu passées dans la culture marocaine.
Second point : le système formel d’enseignement occidental de la musique avec les conservatoires des grandes villes du Maroc, qui ont hérité de l’époque coloniale. Rien n’en sort réellement. Le protectorat au Maroc a laissé beaucoup de place à l’auto-gouvernance, et n’a pas eu la même influence sur les structures politiques profondes qu’en Algérie, par exemple. Le Sultan était la source légitime du pouvoir et toutes les cultures marocaines ont continué à vivre – ce n’est qu’après qu’elles ont subi le choc de la mondialisation, qui a été beaucoup plus fort sur les cultures autochtones à mon sens.
Je n’ai pas l’impression que les musiques occidentales aient déformé les cultures autochtones. Mais, davantage peut-être que la présence coloniale, la musique égyptienne a modelé le Maghreb et le Maroc, depuis l’époque de Nasser. Dans la mesure où les orchestres symphoniques égyptiens se sont modelés sur les orchestres occidentaux, il y a ainsi eu une modification du goût. La mondialisation, qui commençait déjà, est aussi venue par l’Egypte, dont la culture musicale et cinématographique, était omniprésente au Maghreb. Alors que la musique contemporaine européenne n’a pas d’impact au Maroc, la culture égyptienne influe sur le formatage du goût. Le violon s’est substitué au rebab – et encore, le rebab est beaucoup plus présent au Maroc qu’en Algérie ou en Tunisie, notamment en raison de la proximité avec l’Afrique noire. L’oreille s’est tempérée, dans les villes en tous cas – il reste des sources archaïques dans les montagnes, avec des carrures rythmiques qui n’ont pas le lissé des carrures occidentales.
Où est la frontière entre rencontre et perte d’identité ?
A.E. : « La perte d’identité est liée à une dictature qui s’exerce sur la pensée : lorsqu’un compositeur impose sa vision, le seuil est indubitablement franchi. Mais, quand on est dans la rencontre et le respect de l’individu, je ne vois pas comment l’un ou l’autre pourrait perdre son identité. Ici, la rencontre, au surplus, reste éphémère : on n’a pas le temps de s’y “perdre”. Si l’on fait une analogie avec la dynamique du couple, on reste dans la phase passionnelle de la rencontre.
F.D. : « Nous ne sommes pas dans l’industrie du divertissement ou de la variété, où les formats sont ressassés pendant des décennies. Du Slam à l’Atlas ne représente qu’une expérience qui va très vite se métamorphoser dans l’esprit des musiciens qui y ont participé. Chacun va y prendre tel ou tel élément qu’il va intégrer à son langage propre. Du Slam à l’Atlas va ainsi être essaimé, jusqu’à devenir méconnaissable.
Certes, mais si tous les lieux, toutes les institutions, se mettent à ce genre de projet, et à y accaparer les musiciens, viendra un moment où…
F.D. : « Faisons un peu de Darwinisme. La culture amazigh se porte très bien et continue à faire vivre son langage propre pour son public local. Parallèlement, elle entre en conversation avec d’autres mondes musicaux. L’un n’exclut pas l’autre. Quand il y a vitalité, quand une musique continue d’être désirée par la société qui l’a produite, elle perdure, nécessairement.
C’est toute la question de la préservation du patrimoine vivant.
F.D. : « Je ferais une réponse idéaliste : la création est le meilleur antidote à la mort des cultures orales. Ces dialectiques sont superfétatoires. Patrimoine et création vont main dans la main. Les traditions orales, lorsqu’elles sont vivantes, ne cessent de s’inventer et d’être créatives. Aujourd’hui, le facteur qu’il faut apprivoiser, et ce n’est pas une mince affaire, c’est la vitesse de la mondialisation – relisons Paul Virilio. Notre propos à Royaumont est de permettre aux musiciens de régénérer leur propre culture en y incorporant des ingrédients de l’extérieur, comme une bouffée d’air frais.
Entre Casablanca et les montagnes de l’Atlas, il y a 4000 m de dénivelé. Mais ces 4000 m représentent deux mondes absolument différents. Certaines cultures orales, trop rurales ou montagnardes, meurent parce qu’il n’y a plus de société suffisamment vivante pour continuer à les nourrir. Plus aucune de ces cultures ne peut prétendre rester un isolat, car la mondialisation en a fini avec ces isolats. Comment faire ? Quelle est la dose maximum d’interconnexion admissible pour que la création ne déforme pas la tradition ? Impossible à dire. Mais la création reste la clef, elle se nourrit et nourrit les cultures orales par le renouvellement des formes et les interconnexions avec d’autres langages.
Ce projet a-t-il ainsi un sujet extra musical, une réalité socio-politique dont il serait le reflet ?
F.D. : « C’est un problème auquel nous avons été confrontés de front à Agadir, où le doyen de l’université a bien voulu d’un atelier sur le Slam avec Dgiz, mais à la condition que les textes ne remettent jamais en cause le roi ou le pouvoir. De la même manière, Raïssa Fatima Tabaamrant n’hésite pas à mettre directement en cause le pouvoir, mais sans le nommer. On est là au c½ur des problématiques, propres à l’évolution de la société marocaine, mais aussi de la société française : il suffit de voir ce qui se passe dans les banlieues, et les changements radicaux qu’entrainent les migrations.
Il y a évidemment dans mon esprit une part d’intention politique. Aussi bien le Maroc que la France ont besoin de bouger, d’inventer des façons nouvelles d’être anciennes – puisque les façons anciennes ne suffisent plus à produire un modèle du vivre ensemble. Le Maroc a en sus sa propre histoire et sa propre culture : la culture berbère n’a été reconnue par Mohammed VI qu’il y a quatre ou cinq ans. Et la France a bien sûr des problèmes politiques – ce syndrome de petit blanc, de repli sur soi, d’une France blanche, de souche… Pourtant, les faits sont là : les territoires dans lesquels on vit sont interconnectés. On ne compte pas moins de 90 cultures rien qu’en région parisienne. La mixité s’impose. Irréversiblement.
Le colloque que l’on organise dans le cadre de ces journées à Royaumont et à Aubervilliers traite justement de ces problématiques : Musiques mixtes et territoires urbains. Les sujets des diverses interventions témoignent bien de cette orientation politico-artistique : transculturalité contre les ghettos, problématique des mégalopoles, politiques publiques en terme de culture et d’aménagement du territoire, etc.
Je pense qu’il y a une force dans ce projet, qui s’est ressenti lors de notre réunion à la préfecture de Seine-Saint-Denis, lorsque l’envie de nous soutenir est née au sein de l’administration et de diverses institutions, lorsqu’ils ont compris que les ateliers proposés en Seine-Saint-Denis allaient bénéficier du rayonnement de la création. Nous ne compartimentons pas, d’une part la création, de l’autre les ateliers. L’énergie de l’une se retrouve dans les autres. On reste dans une oralité véritable, jusque dans les ateliers.
Royaumont est une institution, qu’on le veuille ou non. Elle a une aura non négligeable, à la fois par son statut d’ancienne abbaye, et pour son projet, qui est de promouvoir la musique ancienne, la musique contemporaine, et les musiques improvisées. En tant que telle, n’a-t-elle pas une influence « aseptisante » sur les medias artistiques qui y pénètrent ? Et surtout sur les traditions musicales ?
F.D. : « Aucun lieu n’est neutre. L’Abbaye de Royaumont moins qu’un autre : inscrit dans l’histoire et dans la religion (l’abbaye, l’orgue, la chaire du lecteur, la voûte gothique). Mais Royaumont est un lieu qui respire. Ses géométries sont multiples et elle recèle de nombreux petits endroits, aux espaces et volumes variés, entre lesquels on peut circuler — je me refuse à confiner le public dans un lieu unique avec une représentation frontale. Royaumont, c’est aussi la nature qui entoure l’abbaye, la verdure et l’eau. Les gens s’y sentent bien, se posent, s’apaisent. La masse de l’abbaye impressionne les musiciens, surtout quand ils viennent de loin. Les uns sont sensibles à l’herbe, les autres à l’architecture. Ils y respirent plus librement et puisent en eux-mêmes avec plus de relâchement.
Quand je suis en production à Royaumont, je laisse toutes mes affaires, papiers, argent, portable, dans ma chambre. Tout est pris en charge. C’est d’un tel repos, pour tout le monde, de ne plus être le sujet permanent d’une transaction financière. Royaumont est à la fois à l’écart et dans le siècle. Evidemment, c’est la une vision idéaliste, qui ne fonctionne pas à chaque fois.
A.E. : « Quand on passe une semaine en résidence à Royaumont - on pourrait être à 3000 km ou à 5 km de Paris, ça ne changerait rien. On vit coupé du monde. Ni télé, ni radio. On est en immersion complète, hors de l’actualité. Quand on sort de là, qu’on prend la voiture et qu’on met France Info, le contraste est violent ! L’architecture joue énormément.
Comme pour Du griot au slameur, on recherchera dans Du Slam à l’Atlas une convivialité entre le public et les artistes. On sera dans la salle des charpentes, un endroit où l’on peut créer un sentiment d’intimité chaleureuse. Mais, pour Raissa Tabaamrant, par exemple, l’expérience de chanter ici sera très différente de celle qu’elle fait devant son public à Agadir, très réactif et qui la connaît très bien. Je serais d’ailleurs curieux de savoir comment elle-même va ressentir cette différence.
F.D. : « Quant à l’effet anesthésiant, aseptisant ou formatant de l’institution, je ne sais pas dans quelle mesure il agit. Je sais que je suis déterminé par ma culture, mon éducation, mes études - c’est incontestable. Les réflexions, que je propose aux musiciens et celles qu’ils me renvoient, en sont indéniablement empreintes, mais je ne fais que proposer des hypothèses de travail qui ensuite doivent aller jusqu’à la diffusion, et s’exposer ainsi au public, à la critique.
Si l’on tente de ne pas formater la création a priori, la difficulté a contrario est justement de trouver un format suffisamment souple pour que ces expériences, quand elles sont réussies, puissent tourner. Il faut donc fixer la forme, et qu’on puisse retrouver, au moins dans une proportion d’énergie significative, à Tanger ou à Aix, l’émotion si forte que l’on a éprouvée à Royaumont.
Pourquoi, dans le cadre du projet, ne pas avoir donné plus de place aux diverses cultures musicales en présence, chacune isolément ?
F.D. : « On le fait en partie à Royaumont avec deux concerts de chant berbère de l’Atlas, par Raissa Tabaamrant, pour montrer l’une des principales sources Du Slam à l’Atlas, et un dîner conçu par Hassan, le cuisinier marocain de Royaumont, et on le fera in extenso dans le cadre du prochain festival d’Aix-en-Provence. On invite ainsi le public à un voyage, une expérience de vie que l’espace de la Saison Musicale de Royaumont rend possible trois jours durant.
Comment sont payés les différents artistes ?
F.D. : « Entre les musiciens français et marocains, la rémunération n’est pas équivalente, tout simplement à cause de l’écart des niveaux de vie des deux pays. Pour les commandes d’auteur, la conception de l’architecture d’ensemble et la direction musicale, par Andy Emler nécessite un plus gros travail qui exige bien plus de responsabilités que les autres. Dgiz, Khalid, et Fatima ont également reçu des contrats de commande, pour écrire des textes et des chants nouveaux, en sus des cachets de performance. »
> Du Slam à l’Atlas, les 8, 9 et 10 octobre à 20h45, à la Fondation Royaumont.
Photos : D.R.
Frédéric Deval : « Depuis l’expérience Le Rythme de la parole, il y a quelques années avec Keyvan Chemirani, l’une de nos hypothèses de travail est, dans une recherche des universaux culturels, que la parole rythmique est une constante d’une majorité de cultures, et que cet élément structurant du langage – un mot utilisé pour sa sonorité et sa pulsation récurrente – peut donner lieu, même à notre époque de mondialisation, à un dialogue entre des individus issus de cultures différentes : griots maliens, slameurs français et marocains, rwâyés berbères, compositeurs et improvisateurs européens… Cette grande dame du chant berbère de l’Atlas qu’est Raissa Fatima Tabaamrant n’avait l’an dernier jamais entendu Khalid Moukdar, ni même du slam marocain, et vice versa. Quant à Khalid Moukdar, il ne connaissait rien du slam de Dgiz. Et pourtant, le dialogue a eu lieu.
Dans Du Slam à l’Atlas, la parole rythmique est ainsi le personnage central, invisible, autour duquel s’organise une rencontre d’égal à égal et se créent des liens, des points d’entrée d’un langage à l’autre. Elle joue le rôle de passeur entre Marocains de cultures différentes et entre cultures marocaines et françaises. Il y a là multitude de fils, qu’il s’agit de tisser pour créer une trame.
La parole rythmique devient donc un langage commun, que tout le monde s’approprie ?
Andy Emler : « C’est le but : chacun contribue à ce langage commun. Chacun nous amène sa parole, que nous allons devoir nous approprier. Non pas la mettre à notre sauce, mais la travailler à notre tour, avec nos propres outils. Le saxophoniste explorera le jeu du rebab marocain ou le batteur de jazz essaiera de jouer de la percussion marocaine sur sa batterie, sans plaquer son savoir ni tenter une simple imitation. Et inversement.
En quoi cette démarche se distingue-t-elle de celle de la « fusion », dont les exemples sont si nombreux depuis plus de vingt ans ?
A.E. : « Notre propos n’est pas de faire un b½uf, ce qu’on a déjà entendu des millions de fois, mais davantage de créer la rencontre, entre tradition arabe, tradition berbère, slam français et marocain, entre les genres et les styles.
On prend donc des slameurs français et marocains, des musiciens marocains et berbères apportant chacun leurs bagages de thèmes traditionnels – des musiques monodiques, avec des jeux de questions/réponses entre voix et instruments – et un quintette de jazz. A partir de ce matériau d’une richesse incroyable, nous élaborons ensemble un discours cohérent dans lequel chacun aura sa place. C'est une démarche beaucoup plus rare. Si, dans les premiers temps, ce que nous faisions s'apparentait à de la fusion, les univers musicaux se sont bientôt interpénétrés de manière bien plus profonde, créant un système musical neuf. Nous ne nous contentons pas de jouer sur des modes, nous composons. Nous voulons tous nous approprier les langages de chacun au sein d'une composition plus vaste. Et nous devons nous-mêmes nous y habituer, faire nôtre ce système inouï, ce qui n’est pas non plus habituel.
Comment organise-t-on cette rencontre ?
A.E. : « Ce sont des mois de travail, qui commencent en octobre 2009, avec un premier voyage au Maroc pour rencontrer les artistes et s’imprégner de leurs personnalités et de leurs musiques. Puis une première résidence, fin mai-début juin 2010, qui s’est assez bien passée, même si le travail a été lent. On a eu besoin de temps, et j’avoue que les musiciens européens ont plus facilement pénétré l’univers des musiques marocaines que l’inverse.
Ce n’est qu’à la deuxième résidence que nous avons réussi à les amener à des choses qui ne sont pas dans leurs habitudes, pour obtenir une unité d’orchestre, un son cohérent global, avec, comme référence constante, la parole rythmique, le slam, le chant. Ce n’était pas encore l’idéal espéré, mais on s’en approchait.
F.D. : « Un jour, Andy Emler a essayé de leur faire travailler un rythme en tapant dans les mains, pensant qu’un quart d’heure serait suffisant pour que chacun le maîtrise : trois quarts d’heure plus tard, ils y étaient toujours ! Petit décalage, grands effets. Car c’est là qu’apparaît l’écart entre les cultures. La pensée musicale et la pensée rythmique sont fortement liées au contexte historique de leur création ainsi que de leur performance originelle. En guise d’exemple, Mehdi Nassouline, extraordinaire polyinstrumentiste marocain, qui a un pied dans toutes les traditions musicales marocaines, disait ainsi à Andy : “ Le premier temps chez toi, c’est le troisième chez moi ! ”
Pour revenir à l’hypothèse sur la parole rythmique, cette différence entre les pensées rythmiques peut-elle trouver son origine dans le langage lui-même ? A la scansion propre de chaque langue ?
A.E. : « Chacun voit le rythme à sa façon. Khalid (qui chante essentiellement en arabe marocain) et Dgiz en ont des visions très différentes, sans qu’aucune ne soit plus ouverte que les autres.
F.D. : « Chacun a son flot, son débit, les rythmes et les mesures dont il est familier, une aptitude plus ou moins grande à les changer.
En quoi consistaient les incompréhensions et les « résistances » de la part des musiciens en présence ?
A.E. : « Au début, Raïssa Fatima Tabaamrant ne voulait pas improviser à la voix, en duo avec le piano – et pourtant ça s’est bien passé ensuite. Mais elle a ses textes et ses chansons, et ne voyait pas bien où je voulais en venir. Il y a là un aspect qui dépasse le musical, celui de la rencontre, de la confiance. Le deuxième ou le troisième jour, j’ai essayé autre chose : plutôt que d’accompagner harmoniquement au piano, j’ai imité un instrument de percussion avec les graves de mon piano, pour rester dans un contexte sonore plus ou moins afro-maghrébin. Mise à l’aise, elle a commencé à chanter. Comme j’ai une bonne oreille, je me suis mis à suivre ses notes, comme un balafon africain, puis à harmoniser son chant. Enfin, j’ai repris son chant au clavier, en lui ajoutant une dimension harmonique à l’européenne, mais en jouant du piano comme on jouerait sur un sitar, par exemple – même si je n’ai pas de quart de ton, je peux préserver l’esprit modal de cette musique. Jouer du piano à l’occidentale n’a, dans ce contexte, aucun intérêt ; cela ne produit que de la variété, et pas forcément la meilleure. Ce n’est que le cinquième jour qu’elle m’a avouer comprendre.
F.D. : « Il faut définir la zone de recouvrement, qui rend possible une invention commune. Raïssa est une femme dont on baise la main dans les rues d’Agadir et dans les villages de l’Atlas. Elle délivre une parole sibylline, indirecte, quasi prophétique dans ses allures ; ce sont des aphorismes, parlés ou chantés, sentences, critiques sociales ou morales très poétiques, miroirs de la société. Elle est “ ce que dit la bouche d’ombre ”, pour reprendre Victor Hugo et n’est certes pas habituée au duo.
A.E. : « Les Marocains ne comprenaient d’ailleurs pas pourquoi on entendait ces thèmes à ce moment-là, alors qu’on les rejouait plus tard. La dimension formelle de la chose – comprenant réexpositions, transpositions, variations rythmiques sur un élément de thème – leur était étrangère, de même que sa dimension verticale – eux qui sont davantage habitués au monodique. On a dû réexpliquer plusieurs fois que ce n’était justement pas un morceau, mais que je voulais établir un lien, une cohérence dans le déroulement de la soirée, du premier au dernier souffle – ils ont plus l’habitude de la fusion, où l’on enchaîne indifféremment des morceaux indépendants les uns des autres.
Qu’est-ce qui distingue ce projet de ceux qui l’ont précédé ? Quels enseignements avez-vous tirés des expériences précédentes ?
F.D. : « C’est la même matrice de Du Griot au Slameur (2008) qu’on a translatée, avec des personnalités et cultures différentes. On constate d’ailleurs, et ce n’est pas un hasard, que quelques personnalités musicales de Du Slam à l’Atlas sont des constantes par rapport à Du Griot au Slameur (Andy Emler, Dgiz, Guillaume Orti ou Taoufik Izeddiou qui fait des impros dansées avec certains musiciens). Mais il y a cette fois une personne qui donne une direction au travail, un véritable directeur artistique : Andy Emler.
Du Griot au Slameur nous avait offert de très grandes réussites, notamment dans les petites formes, mais l’architecture était bancale et, du point de vue des musiciens européens, beaucoup de temps a été perdu dans les prémices du travail, pour se comprendre, et décider d’une direction commune. Il y avait une superbe énergie, des étincelles, qu’un bon directeur musical aurait peut-être mieux su canaliser.
A.E. : « C’était très démocratique, tout le monde avait la liberté de proposer, de disposer, d’imposer. Composer ainsi à plusieurs peut être extrêmement difficile et dangereux. A quinze, c’est presque impossible. Petit à petit, l’architecture (le scénario) s’est mise en place avec les différents éléments qui s’étaient révélés lors des différentes résidences. Finalement, ce n’est que l’urgence de l’échéance qui a fait le tri. Cette année, si le travail reste assez démocratique – chacun est libre de venir proposer –, quand un problème se pose, je tranche en dernier recours.
En quoi cette démarche se distingue-t-elle de celles des compositeurs férus d’ethnomusicologies ?
F.D. : « Quand Bartók intègre des éléments de Transylvanie dans son langage, quand Ohana intègre des éléments de flamenco, l’alchimie de la forme se fait dans le creuset de leur for intérieur. C’est Bartók face à Bartók, Ohana face à Ohana. Quand Royaumont propose ces voyages transculturels, c’est un dialogue entre les musiciens. Pour le projet commun (2007) de Alexandros Markeas et l’ensemble de polyphonies géorgiennes de tradition orale, Anchi Skhati, ce n’est pas le seul Markeas qui fond, comme dans une fonderie de moulage, tous les ingrédients ensemble, c’est un dialogue d’égal à égal entre Markeas et l’entité multiple des douze chanteurs géorgiens. Même si Andy Emler a dans ce projet un rôle de directeur artistique, le dialogue s’instaure entre chacun des artistes en présence. Pour chacun des directeurs musicaux de ces rencontres, l’invention de la forme est un tout autre défi quand on a affaire à un dialogue en chair et en os avec ses musiciens, que lorsqu’on butine des éléments de langage qu’on incorpore à son propre univers, pour les organiser dans une forme qu’on est seul à écrire. Il y a là une dimension collective à la création – qui se répercute jusqu’à la répartition des droits à la SACEM.
A.E. : « De la partition que j’avais préparée en amont du travail et que j’avais amené lors des premières résidences, il reste à peine un tiers : tout le reste a changé au gré des diverses propositions. J’ai jeté beaucoup – parce que les uns ou les autres m’ont proposé des morceaux de leur cru qui correspondaient à la dynamique de la parole rythmique. Ça donne une autre cohérence, différente de celle à laquelle on avait pensée a priori. Je reste totalement ouvert.
F.D. : « C’est une autre des grandes différences par rapport à ce qu’on appelle la tradition écrite européenne. Fixer définitivement, oui, mais après la rencontre, après avoir intégré dans la forme finale les apports de tous les musiciens. Et non la posture du compositeur qui arrive avec son monument, déjà déposé à la SACEM, que le musicien est forcé de jouer en l’état. J’ai entendu Joëlle Léandre dire : “ Il y a eu un jour où j’en ai eu assez d’être l’exécutante de la musique des autres. ” Dans toutes nos expériences, les musiciens ne sont pas de simples exécutants. Même s’ils sont réunis autour d’un directeur musical qui apporte 60% de la musique, ils finissent par s’approprier le matériau qu’ils ont porté ensemble, et auquel ils ont chacun contribué, parfois jusque dans les schémas de construction. C’est un autre rapport à l’architecture musicale, qui déplace radicalement les rapports de l’interprète au compositeur. Ce que nous faisons est innovant aussi en cela, avec toutes les scories et tous les déchets que cela suppose.
A.E. : « Et il est fort probable que la performance du 8 octobre soit différente de celle que l’on fera à Aix-en-Provence en juillet prochain. Plusieurs étapes sont mises en place. La chronologie est à l’opposé de celle suivie par la plupart des créations contemporaines : le compositeur compose. Trois jours avant le concert, les musiciens ont rendez-vous pour la première répétition. Puis, ils montent la pièce et la jouent une, deux ou trois fois. Mais il n’y a pas le temps de remanier. Cela suppose, dans notre cas, une équipe fédérée par une réelle alchimie humaine – qui n’a pas été forcément facile à faire naître.
Andy Emler, vous êtes vous-même, coordinateur du projet, directeur artistique, dans une tradition écrite. Comment la transmission se passe-t-elle ?
A.E. : « Par la transmission orale ! Pour apprendre à notre virtuose du monocorde des thèmes que j’avais amenés, je l’ai pris à part, en face à face, pendant une heure et demie. Cela permet aussi de réajuster et on sait ainsi où on veut aller. Notre saxophoniste suggérait, pour la prochaine résidence, des moments de duo dans le travail, pour que chacun comprenne la pratique de chacune des musiques – et pas uniquement dans le cadre du collectif. Quant à moi, je notais ce qu’ils me proposaient. J’ai relevé pour mémoire tout le travail – pour que tout le monde puisse s’y référer.
Qu’est-ce qu’« écrire » dans ce contexte ?
A.E. : « L’ouverture instrumentale est une espèce de medley, d’offertoire qui réunit presque toutes les thématiques que l’on va utiliser, au moins dans la musique. Les Marocains ne comprenaient d’ailleurs pas pourquoi on entendait ces thèmes à ce moment-là, alors qu’on les rejouait plus tard. La dimension formelle de la chose – comprenant réexpositions, transpositions, variations rythmiques sur un élément de thème – leur était étrangère, de même que sa dimension verticale – eux qui sont davantage habitués au monodique. On a dû réexpliquer plusieurs fois qu’il ne s’agissait pas d’un morceau, mais d’ un lien, d’une cohérence dans le déroulement de la soirée, du premier au dernier souffle. Ils ont davantage l’habitude de la fusion, où l’on enchaîne indifféremment des morceaux indépendants les uns des autres.
La notion de développement d’un matériau thématique qui se transforme et celle de polyphonie seraient donc typiques de la musique occidentale de tradition écrite ?
F.D. : « Elles existent parfois ailleurs, mais je ne pense pas qu’elles entrent alors dans une démarche d’auteur. Si l’on prend l’exemple des polyphonies pygmées Aka, que nous avons découvertes grâce au travail de Simha Arom et qu’a utilisées Ligeti : la succession et la superposition de ces notes est d’une complexité incroyable mais ne relève pas d’une démarche de création de forme. On joue certaines pièces dans certaines circonstances.
Cette démarche d’écriture et d’inscription dans un contexte plus vaste fige-t-elle la musique ? Plaquerait-on une macrostructure (du type « symphonie beethovenienne », par exemple) dans laquelle on insèrerait chaque élément des différentes cultures, chaque proposition et parole rythmiques des divers musiciens ?
A.E. : « Non, car, d’une part, nous préservons certains aspects de transe et de liberté improvisatrice propres à ces musiques, et, d’autre part, le travail de réécriture est constant. Le propos est, simplement, d’apporter une cohérence au déroulement musical. Et de trouver de l’espace pour tous : que chacun soit heureux de faire partie du résultat sonore global et que chacun ait aussi la possibilité de mettre en valeur son art. Si ces deux conditions sont réunies, le plaisir et la réalité de la rencontre (ce n’est pas juste un b½uf), c’est un bon début.
Il y a là un aspect impermanent : quand Bartók écrit, sa pièce peut être interprétée par tous les musiciens qui viennent après lui. Quant aux traditions orales, elles sont pérennisées, au moins en leur c½ur. Dans Du Slam à l’Atlas, l’écriture dépend intrinsèquement de chaque personnalité. Non seulement elle varie d’une soirée à l’autre, par son aspect improvisé et vivant, mais elle est in-reproductible, dès lors que les personnalités en présence varient.
F.D. : « Je l’ai toujours dit, à Royaumont, ce sont des rencontres inter-personnelles. A l’ère de la mondialisation, ralentir la circulation tous azimuts de l’information musicale devient d’autant plus nécessaire, pour privilégier cet espace-temps où la rencontre peut se dilater. C’est intuitu personae. Il y a effectivement quelque chose d’original et d’insubstituable, lié aux personnalités musicales représentées. Au cours du travail, le joueur de rebab a été remplacé et le travail a perdu de son contenu et de sa richesse. Mais c’est peut-être pousser le bouchon un peu loin : à idiome constant, la substitution pourrait se faire, jusque dans le slam – même si Dgiz a une telle virtuosité poétique et rythmique qu’on n’imagine pas un autre slameur français prendre sa place.
A.E. : « Ce serait intéressant d’imaginer Du Slam à l’Atlas avec d’autres musiciens, mais m’étant moi-même tant inspiré pour l’écriture de leurs musiques propres – du chant de Fatima par exemple, si unique dans la tradition berbère – que je ne vois pas très bien comment. Ou alors il faudrait changer une grande partie du travail.
Oralité, polyculturalité et société
Dans le projet, vous articulez également la dualité entre oralités dites traditionnelles et oralité urbaines : mais l’oralité urbaine n’est-elle pas simplement l’oralité traditionnelle transposée ? Le déplacement de la population, de la culture, n’est-il pas justement responsable de la naissance du slam ?
F.D. : « Je ne crois pas. Ou seulement en partie. On veut toujours se sentir pousser des racines sous les pieds. Le fait est que tous ces idiomes se métamorphosent. Bien sûr, on peut entendre la pulsation du rap nord américain dans ce que fait Dgiz, mais sont mêlées également plusieurs influences qui s’étendent de la poésie française, du rap français, au chaabi algérien et marocain. Le produit de la migration, ce sont des idiomes interconnectés.
Lors d’un débat il y a dix ans à Royaumont, Bernard Lortat-Jacob proposait l’hypothèse suivante : plus il y a éloignement, plus il y a perte – l’éloignement considéré étant celui du territoire ethnomusicologique. Selon lui, la migration s’accompagnait immanquablement d’une perte de substance de ces idiomes musicaux d’origine. Je pense au contraire que les migrations déclenchent un grand potentiel de création, dont les références ne sont plus les mêmes. Le bilan entre ce qui a été perdu par rapport à la culture dite d’origine, qui est elle-même le produit d’innombrables interconnexions, et ce qui a été gagné lors du processus de migration/création, est difficile à établir. Mais on ne peut mesurer la valeur ajoutée artistique qu’à l’aune de la communication avec un public. Que transmet-on, lorsqu’on a, certes, un peu perdu de sa culture d’origine, mais qu’on s’est approprié les ingrédients si variés qui pullulent dans la mégalopole Ile-de-France ? La question se pose davantage en termes d’“être ensemble”. L’artiste est-il plus “en phase” avec son public en griot à Bamako, ou en slameur à Bobigny ?
Le slam est-il une tradition orale ?
F.D. : « Pour qu'il y ait tradition, il faut déjà qu'il y ait une certaine épaisseur d'histoire. Une tradition n'est qu'un événement qui se reproduit. On peut dire qu'il y a une tradition du slam depuis le fameux film Slam (1998) de Marc Levin. Une culture est née et s'est transmise depuis quinze ans maintenant. Arrivée en France il y a une dizaine d'années, décalée, translatée, elle s'est ramifiée en de nombreux courants. Venue sur les ailes du rap américain, elle a rencontré le vieux courant de la poésie – littéraire et sonore – française, ainsi que toutes les oralités d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, émigrées en France. Tout ce melting-pot a donné naissance au slam à la française. On peut donc commencer à parler d’une culture, et donc d’une “tradition”. La question de la transmission orale du slam est celle de la frontière entre écriture et improvisation : on a affaire soit à un texte déjà écrit et “performé” oralement sur scène, soit à une improvisation, également “performée” oralement sur scène.
Les oralités anciennes ont toutes plus ou moins trait à la spiritualité ou à une forme de transcendance. Le slam français, beaucoup moins, sinon pas du tout. Comment articulez-vous cette dualité au sein du projet ?
F.D. : « Cette problématique est double. Tout d’abord, on ne peut affirmer que les oralités anciennes, telles qu’elles se présentent aujourd’hui, sont toutes spirituelles. Certains des aphorismes de Raissa Tabaamrant sont liés au religieux, au spirituel, mais de nombreux autres se rapportent davantage à la critique sociale et/ou morale.
D’autre part, on ne peut pas affirmer que les oralités urbaines sont totalement laïques et sécularisées. Même Dgiz est en questionnement sur ce sujet – on l’a vu dans un précédent projet que nous avons fait ensemble, A quel Dieu parles-tu ?, avec Valère Novarina, qui sera repris à l’Odéon, le 19 mars prochain. Simplement, les artistes qui se situent dans les oralités urbaines aujourd’hui – sauf ceux pris dans un fanatisme monothéiste –, n’ont pas de système spirituel préconstruit, transmis par une tradition religieuse institutionnalisée. Si l’on se rapproche du foyer des cultures anciennes, comme celles de l’Inde ou le Vaudou au Bénin, là, la spiritualité prend certes davantage de place, mais il existe entre l’un et l’autre un arc-en-ciel de nuances.
On a parlé d’ethnomusicologie – qu’elle date de l’époque coloniale ou qu’elle soit plus moderne –, mais interrogeons-nous à présent à rebours : du fait de la mondialisation et de la globalisation culturelle et médiatique, les oralités anciennes portent-elles l’empreinte de la présence occidentale ?
F.D. : « Sans avoir une vision globale, j’aurais deux ou trois éléments de réponse, qui remontent aussi à l’année du Maroc, programme que j’ai mené à Royaumont en 1999. Tout d’abord, parlons du cas d’Ahmed Essyad qui serait davantage un contre-exemple. Né en 1939, ce Marocain a décidé de venir étudier la musique en France, après avoir écouté les Suites de Bach à seize ans. Puis, ce fut son passage auprès de Max Deutsch, des postsériels, le développement d’une écriture personnelle, l’écriture d’opéras, de commandes à Radio France… Voilà quelqu’un qui a été touché par l’esprit de la composition européenne et qui n’a cessé d’essayer de faire la jonction avec la musique qu’il entendait chez lui – musique arabo-andalouse, musique berbère de l’Atlas. C’est un contre-exemple resté unique et, d’ailleurs, relativement ignoré dans son pays : les grandes formes de la composition européennes sont extrêmement peu passées dans la culture marocaine.
Second point : le système formel d’enseignement occidental de la musique avec les conservatoires des grandes villes du Maroc, qui ont hérité de l’époque coloniale. Rien n’en sort réellement. Le protectorat au Maroc a laissé beaucoup de place à l’auto-gouvernance, et n’a pas eu la même influence sur les structures politiques profondes qu’en Algérie, par exemple. Le Sultan était la source légitime du pouvoir et toutes les cultures marocaines ont continué à vivre – ce n’est qu’après qu’elles ont subi le choc de la mondialisation, qui a été beaucoup plus fort sur les cultures autochtones à mon sens.
Je n’ai pas l’impression que les musiques occidentales aient déformé les cultures autochtones. Mais, davantage peut-être que la présence coloniale, la musique égyptienne a modelé le Maghreb et le Maroc, depuis l’époque de Nasser. Dans la mesure où les orchestres symphoniques égyptiens se sont modelés sur les orchestres occidentaux, il y a ainsi eu une modification du goût. La mondialisation, qui commençait déjà, est aussi venue par l’Egypte, dont la culture musicale et cinématographique, était omniprésente au Maghreb. Alors que la musique contemporaine européenne n’a pas d’impact au Maroc, la culture égyptienne influe sur le formatage du goût. Le violon s’est substitué au rebab – et encore, le rebab est beaucoup plus présent au Maroc qu’en Algérie ou en Tunisie, notamment en raison de la proximité avec l’Afrique noire. L’oreille s’est tempérée, dans les villes en tous cas – il reste des sources archaïques dans les montagnes, avec des carrures rythmiques qui n’ont pas le lissé des carrures occidentales.
Où est la frontière entre rencontre et perte d’identité ?
A.E. : « La perte d’identité est liée à une dictature qui s’exerce sur la pensée : lorsqu’un compositeur impose sa vision, le seuil est indubitablement franchi. Mais, quand on est dans la rencontre et le respect de l’individu, je ne vois pas comment l’un ou l’autre pourrait perdre son identité. Ici, la rencontre, au surplus, reste éphémère : on n’a pas le temps de s’y “perdre”. Si l’on fait une analogie avec la dynamique du couple, on reste dans la phase passionnelle de la rencontre.
F.D. : « Nous ne sommes pas dans l’industrie du divertissement ou de la variété, où les formats sont ressassés pendant des décennies. Du Slam à l’Atlas ne représente qu’une expérience qui va très vite se métamorphoser dans l’esprit des musiciens qui y ont participé. Chacun va y prendre tel ou tel élément qu’il va intégrer à son langage propre. Du Slam à l’Atlas va ainsi être essaimé, jusqu’à devenir méconnaissable.
Certes, mais si tous les lieux, toutes les institutions, se mettent à ce genre de projet, et à y accaparer les musiciens, viendra un moment où…
F.D. : « Faisons un peu de Darwinisme. La culture amazigh se porte très bien et continue à faire vivre son langage propre pour son public local. Parallèlement, elle entre en conversation avec d’autres mondes musicaux. L’un n’exclut pas l’autre. Quand il y a vitalité, quand une musique continue d’être désirée par la société qui l’a produite, elle perdure, nécessairement.
C’est toute la question de la préservation du patrimoine vivant.
F.D. : « Je ferais une réponse idéaliste : la création est le meilleur antidote à la mort des cultures orales. Ces dialectiques sont superfétatoires. Patrimoine et création vont main dans la main. Les traditions orales, lorsqu’elles sont vivantes, ne cessent de s’inventer et d’être créatives. Aujourd’hui, le facteur qu’il faut apprivoiser, et ce n’est pas une mince affaire, c’est la vitesse de la mondialisation – relisons Paul Virilio. Notre propos à Royaumont est de permettre aux musiciens de régénérer leur propre culture en y incorporant des ingrédients de l’extérieur, comme une bouffée d’air frais.
Entre Casablanca et les montagnes de l’Atlas, il y a 4000 m de dénivelé. Mais ces 4000 m représentent deux mondes absolument différents. Certaines cultures orales, trop rurales ou montagnardes, meurent parce qu’il n’y a plus de société suffisamment vivante pour continuer à les nourrir. Plus aucune de ces cultures ne peut prétendre rester un isolat, car la mondialisation en a fini avec ces isolats. Comment faire ? Quelle est la dose maximum d’interconnexion admissible pour que la création ne déforme pas la tradition ? Impossible à dire. Mais la création reste la clef, elle se nourrit et nourrit les cultures orales par le renouvellement des formes et les interconnexions avec d’autres langages.
Ce projet a-t-il ainsi un sujet extra musical, une réalité socio-politique dont il serait le reflet ?
F.D. : « C’est un problème auquel nous avons été confrontés de front à Agadir, où le doyen de l’université a bien voulu d’un atelier sur le Slam avec Dgiz, mais à la condition que les textes ne remettent jamais en cause le roi ou le pouvoir. De la même manière, Raïssa Fatima Tabaamrant n’hésite pas à mettre directement en cause le pouvoir, mais sans le nommer. On est là au c½ur des problématiques, propres à l’évolution de la société marocaine, mais aussi de la société française : il suffit de voir ce qui se passe dans les banlieues, et les changements radicaux qu’entrainent les migrations.
Il y a évidemment dans mon esprit une part d’intention politique. Aussi bien le Maroc que la France ont besoin de bouger, d’inventer des façons nouvelles d’être anciennes – puisque les façons anciennes ne suffisent plus à produire un modèle du vivre ensemble. Le Maroc a en sus sa propre histoire et sa propre culture : la culture berbère n’a été reconnue par Mohammed VI qu’il y a quatre ou cinq ans. Et la France a bien sûr des problèmes politiques – ce syndrome de petit blanc, de repli sur soi, d’une France blanche, de souche… Pourtant, les faits sont là : les territoires dans lesquels on vit sont interconnectés. On ne compte pas moins de 90 cultures rien qu’en région parisienne. La mixité s’impose. Irréversiblement.
Le colloque que l’on organise dans le cadre de ces journées à Royaumont et à Aubervilliers traite justement de ces problématiques : Musiques mixtes et territoires urbains. Les sujets des diverses interventions témoignent bien de cette orientation politico-artistique : transculturalité contre les ghettos, problématique des mégalopoles, politiques publiques en terme de culture et d’aménagement du territoire, etc.
Je pense qu’il y a une force dans ce projet, qui s’est ressenti lors de notre réunion à la préfecture de Seine-Saint-Denis, lorsque l’envie de nous soutenir est née au sein de l’administration et de diverses institutions, lorsqu’ils ont compris que les ateliers proposés en Seine-Saint-Denis allaient bénéficier du rayonnement de la création. Nous ne compartimentons pas, d’une part la création, de l’autre les ateliers. L’énergie de l’une se retrouve dans les autres. On reste dans une oralité véritable, jusque dans les ateliers.
Royaumont est une institution, qu’on le veuille ou non. Elle a une aura non négligeable, à la fois par son statut d’ancienne abbaye, et pour son projet, qui est de promouvoir la musique ancienne, la musique contemporaine, et les musiques improvisées. En tant que telle, n’a-t-elle pas une influence « aseptisante » sur les medias artistiques qui y pénètrent ? Et surtout sur les traditions musicales ?
F.D. : « Aucun lieu n’est neutre. L’Abbaye de Royaumont moins qu’un autre : inscrit dans l’histoire et dans la religion (l’abbaye, l’orgue, la chaire du lecteur, la voûte gothique). Mais Royaumont est un lieu qui respire. Ses géométries sont multiples et elle recèle de nombreux petits endroits, aux espaces et volumes variés, entre lesquels on peut circuler — je me refuse à confiner le public dans un lieu unique avec une représentation frontale. Royaumont, c’est aussi la nature qui entoure l’abbaye, la verdure et l’eau. Les gens s’y sentent bien, se posent, s’apaisent. La masse de l’abbaye impressionne les musiciens, surtout quand ils viennent de loin. Les uns sont sensibles à l’herbe, les autres à l’architecture. Ils y respirent plus librement et puisent en eux-mêmes avec plus de relâchement.
Quand je suis en production à Royaumont, je laisse toutes mes affaires, papiers, argent, portable, dans ma chambre. Tout est pris en charge. C’est d’un tel repos, pour tout le monde, de ne plus être le sujet permanent d’une transaction financière. Royaumont est à la fois à l’écart et dans le siècle. Evidemment, c’est la une vision idéaliste, qui ne fonctionne pas à chaque fois.
A.E. : « Quand on passe une semaine en résidence à Royaumont - on pourrait être à 3000 km ou à 5 km de Paris, ça ne changerait rien. On vit coupé du monde. Ni télé, ni radio. On est en immersion complète, hors de l’actualité. Quand on sort de là, qu’on prend la voiture et qu’on met France Info, le contraste est violent ! L’architecture joue énormément.
Comme pour Du griot au slameur, on recherchera dans Du Slam à l’Atlas une convivialité entre le public et les artistes. On sera dans la salle des charpentes, un endroit où l’on peut créer un sentiment d’intimité chaleureuse. Mais, pour Raissa Tabaamrant, par exemple, l’expérience de chanter ici sera très différente de celle qu’elle fait devant son public à Agadir, très réactif et qui la connaît très bien. Je serais d’ailleurs curieux de savoir comment elle-même va ressentir cette différence.
F.D. : « Quant à l’effet anesthésiant, aseptisant ou formatant de l’institution, je ne sais pas dans quelle mesure il agit. Je sais que je suis déterminé par ma culture, mon éducation, mes études - c’est incontestable. Les réflexions, que je propose aux musiciens et celles qu’ils me renvoient, en sont indéniablement empreintes, mais je ne fais que proposer des hypothèses de travail qui ensuite doivent aller jusqu’à la diffusion, et s’exposer ainsi au public, à la critique.
Si l’on tente de ne pas formater la création a priori, la difficulté a contrario est justement de trouver un format suffisamment souple pour que ces expériences, quand elles sont réussies, puissent tourner. Il faut donc fixer la forme, et qu’on puisse retrouver, au moins dans une proportion d’énergie significative, à Tanger ou à Aix, l’émotion si forte que l’on a éprouvée à Royaumont.
Pourquoi, dans le cadre du projet, ne pas avoir donné plus de place aux diverses cultures musicales en présence, chacune isolément ?
F.D. : « On le fait en partie à Royaumont avec deux concerts de chant berbère de l’Atlas, par Raissa Tabaamrant, pour montrer l’une des principales sources Du Slam à l’Atlas, et un dîner conçu par Hassan, le cuisinier marocain de Royaumont, et on le fera in extenso dans le cadre du prochain festival d’Aix-en-Provence. On invite ainsi le public à un voyage, une expérience de vie que l’espace de la Saison Musicale de Royaumont rend possible trois jours durant.
Comment sont payés les différents artistes ?
F.D. : « Entre les musiciens français et marocains, la rémunération n’est pas équivalente, tout simplement à cause de l’écart des niveaux de vie des deux pays. Pour les commandes d’auteur, la conception de l’architecture d’ensemble et la direction musicale, par Andy Emler nécessite un plus gros travail qui exige bien plus de responsabilités que les autres. Dgiz, Khalid, et Fatima ont également reçu des contrats de commande, pour écrire des textes et des chants nouveaux, en sus des cachets de performance. »
> Du Slam à l’Atlas, les 8, 9 et 10 octobre à 20h45, à la Fondation Royaumont.
Photos : D.R.
Lire aussi
-
Chargement...