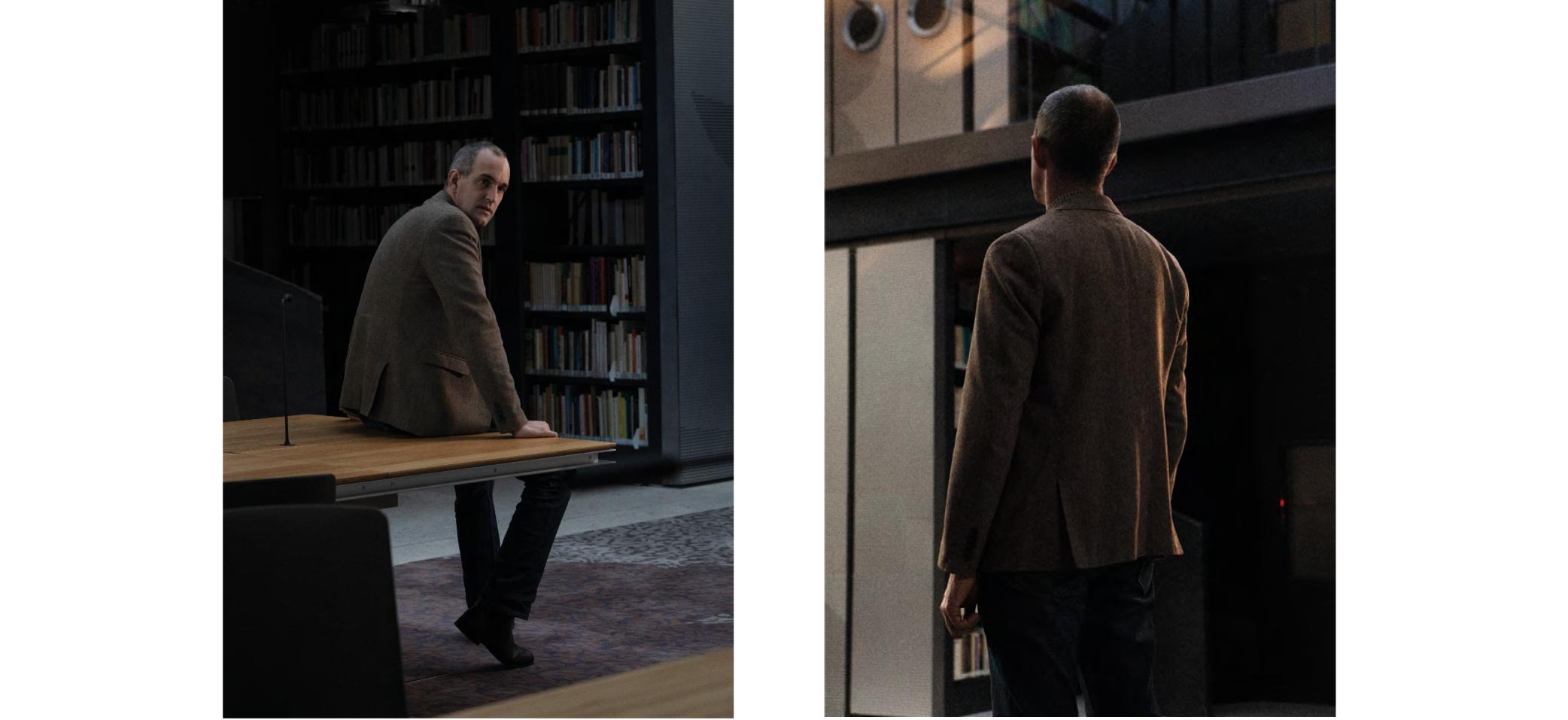Vous remarquez que certains courants écologistes, qui fétichisent la nature, ont tendance à renvoyer les corps queers du côté de la technique (usage d’hormones, procréation médicalement assistée) et donc d’une sorte de post-nature ou de transhumanisme. Est-ce seulement le cas des franges les plus réactionnaires ?
Pas uniquement. Un numéro du journal La Décroissance, paru à l’été 2019, développe l’idée selon laquelle les personnes LGBT+ seraient des avatars d’un libéralisme débridé, que ce soit par rapport aux modifications éventuelles qu’iels apporteraient à leur corps, ou à leur désir de se reproduire. Ce dernier se voit assimilé à une liberté d’exploiter d’autres corps ou d’acheter – des enfants par exemple. En l’occurrence, on peut estampiller cette publication comme réac. Mais des impensés homophobes et transphobes infusent plus largement au sein d’Europe Écologie Les Verts et dans certains interstices de la gauche militante ou altermondialiste. J’ai été horrifié de voir émerger des théories qui opèrent des parallélismes entre les formes de manipulations du corps humain et du vivant de manière plus générale : des comparaisons entre enfants nés par PMA et OGM, par exemple. Ou qui associent, sans distinction, tout ce qui relève de l’usage de biotechnologies – ou d’une technique au service de modifications corporelles pour les personnes trans – à un désir pervers de puissance. Ces accusations alimentent un idéal de « la bonne naturalité » et du « bon corps » qui, lui, n’aurait pas cédé à une volonté irrationnelle de puissance transhumaniste. De la même façon, sous couvert de s’attaquer à la marchandisation des corps des femmes dans le cadre de la gestation pour autrui, la naissance se voit encore représentée comme sacrée. Il y a plein de manières de faire des enfants, et dans cette conception un peu miraculeuse de la naissance plane un autre impensé hétéronormé qu’il est urgent de déconstruire. D’une part parce que cela participe, de fait, à notre exclusion de certains espaces politiques. Notamment des luttes liées à la justice reproductive. D’autre part parce qu’il est essentiel de reconnaître la manière dont nos vies, queers ou non, sont nécessairement traversées ou dépendantes de certaines formes de technologies. Ce qui ne doit pas empêcher, pour autant, d’en produire une critique.
Vous vous méfiez tout autant de ceux qui disent, comme la scientifique Brigitte Baptiste, qu’il « n’y a rien de plus queer que la nature ».
Je suis partagé. Je suis très séduit et intéressé par le travail de cette biologiste colombienne qui montre comment les hybridations, les marges et les anomalies participent aussi d’une forme de résistance et d’adaptation des écosystèmes. Mais je n’ai pas envie de calquer nos vies humaines sur des phénomènes naturels. Il s’agirait plutôt de s’émanciper de l’argument de nature pour légitimer nos existences.
Votre livre commence par un verbatim des débats sur le Mariage pour tous, considéré comme « contre nature » par ses opposants. Était-ce une manière de souligner que les personnes LGBT+ restent des « damnées de l’ordre naturel » malgré quelques avancées, juridiques et sociales ?
À l’époque, ces débats ont été un peu tragicomiques et j’avais envie d’ouvrir le livre sur une tonalité satirique. Pour le jeune pédé d’un peu plus de 20 ans que j’étais, ça a été un moment politique particulièrement intense à vivre. La façon dont toute cette violence LGBT+phobe s’articulait au concept de nature m’a soudain explosé au visage, même si ce n’était en effet pas nouveau. Historiquement, les pratiques, les corps puis l’émergence de sujets déviants ont constamment été associés à des formes d’infertilité ou de contre-naturalité. La question de leur exploitation, dans le système capitaliste, ne pouvait donc pas se jouer exactement au même moment que celle des corps ouvriers, paysans, de ceux des femmes ou des personnes racisées, d’abord envisagés pour leur force de production et de reproduction. Les sujets déviants émergent plus clairement au XIXe siècle, lorsqu’ils sont conceptualisés par des théories médicosociales et la psychiatrie. Il s’agit alors tantôt de les condamner, tantôt de les soigner. Les classes dominantes associent les pratiques homosexuelles ou non-reproductives à la figure du mauvais ouvrier, inutile socialement, qui se laisse aller à une vie de débauche, et qu’il faut faire rentrer dans le rang. Du côté des luttes ouvrières, on les associe plutôt à une forme de décadence, de luxure, qui serait la preuve de la perversion de la classe bourgeoise. Peu importe l’endroit où l’on se place dans l’espace de production ou sur l’échiquier politique : l’existence déviante est perçue comme un fléau social et environnemental qui menace l’idéal d’une bonne société.
Comment l’exploitation capitaliste de ces existences se joue-t-elle aujourd’hui ?
Avec les luttes d’émancipation et des formes relatives d’assimilation, les choses se sont reconfigurées et l’on a vu apparaître des formes de production et de consommation liées à ces identités. Le sociologue Sam Bourcier parle très bien, dans son livre Homo Inc.orporated, de la manière dont, dans certains pays occidentaux, les LGBT+ deviennent aussi des ressources exploitables par les entreprises et les commerces. C’est aussi particulièrement criant sur les plateformes de streaming : leur présence dans des séries ou des films devient un argument marketing. Sous couvert de participer à la représentation d’une diversité, ou de la rendre visible, iels deviennent des « token » : des gages d’humanisme ou de progressisme. Face à cela, creuser et cultiver une dissidence vivace est une lutte, parce que comme tout le monde, on se laisse un peu ensorceler par la société capitaliste et les politiques de diversité. Les causes structurelles des LGBT+phobies ne sont jamais remises en question, mais on se laisse un peu aveugler par des miettes de droits et des mesures politiques cosmétiques. Je ne minimiserai jamais l’accès aux droits et à l’égalité, c’est très important quand on est vulnérables et précaires, mais cela ne peut être l’unique perspective politique pour les transpédégouines. J’aimerais que nous puissions nous autoriser à regarder vers l’avenir, porté.e.s par un idéal transformateur plus total.
Dans Écologies déviantes, vous essayez d’ancrer les existences LGBT+ non du côté de la nature, mais du côté de la vie. En quoi était-ce important ?
Le terme de « vie », dans le prolongement de celui de « vivant », me semble pour le moment plus capable d’échapper aux idéologies dominantes qui traversent le concept de nature. Par ailleurs, l’expérience queer, telle qu’elle a parfois été théorisée ou revendiquée politiquement, s’est beaucoup focalisée sur une forme de vie habitant le présent pour le présent, une forme d’éphémérité, un refus de la reproduction biologique, sous couvert de refuser la reproduction sociale et les institutions qui la soutiennent. Le FHAR – Front homosexuel d’action révolutionnaire – a par exemple revendiqué l’improductivité comme valeur positive. Et je m’interroge beaucoup sur la manière dont il serait possible d’articuler cette critique anticapitaliste de la société et de la famille à des préoccupations pour nos vies futures. Comment retisser un rapport à la vie et un souci du vivant quand on est riches et/ou hantés par cet imaginaire d’infertilité ?
Votre livre retrace quelques histoires d’utopies ayant (eu) lieu en Angleterre et aux États-Unis. Vous semblez enthousiaste, mais jamais dans la connivence absolue avec celles-ci.
Je suis passé par différentes phases : une adhésion d’abord un peu immédiate et puis une prise de recul progressive. J’essaie d’être honnête avec l’effet de séduction et de cultiver la compassion que j’ai pour les personnes dont je raconte l’histoire. Mais un des moteurs de l’écriture a été de me demander : qu’est-ce que je peux écrire qui serait utile politiquement aujourd’hui ? Donc plutôt que de céder à la mythification, j’ai essayé de fournir quelques outils critiques. Par exemple, en dépit de ses positions anti-impérialistes, de ses voyages en Inde et au Sri Lanka pour découvrir l’hindouisme et le yoga, le socialiste Edward Carpenter – dont l’homosexualité a souvent été passée sous silence – est pétri d’orientalisme et n’échappe pas à certains stéréotypes racistes. Peut-être qu’il aurait pu s’émanciper davantage des modes de pensées qu’il tentait de déconstruire, mais ça ne veut pas dire pour autant que sa pensée n’est pas importante.
En quoi sa pensée est-elle si importante, justement ?
Parce qu’il fait du corps, de la vie qui le traverse, un repère à partir duquel organiser une pensée politique. Ce n’est pas pour rien qu’il s’est initié à des formes de yoga, qu’il pratiquait le naturisme chez lui ou qu’il valorisait énormément le travail manuel. Mais s’il repart de la corporéité, il ne sombre jamais dans une sorte de sacralisation hétéronormative et binaire d’un corps masculin d’un côté, et féminin de l’autre. Il réaffirme sa préoccupation pour la bonne santé des corps – qu’il associe également aux sujets déviants – et en même temps il élargit constamment ses réflexions : qu’est-ce que le désir ? Qu’est-ce que le genre ? Comment peut-on se situer sur des continuums entre féminin et masculin ? Par ailleurs, la décroissance qu’il a tissé dans sa vie pratique et quotidienne, qu’il appellait « la vie simplifiée », place la question des relations au centre : l’amitié, la camaraderie, le souci de soi et des autres. Ça peut paraître un peu cul-cul, mais c’est l’amour en fait ! Il s’agit de se débarrasser des rapports mercantiles et hiérarchiques pour retrouver des rapports d’attachement réciproque, d’affection, d’affinité amoureuse et sexuelle. Et la dernière chose, c’est qu’il a réussi à créer un espace – la ferme de Millthorpe – à la fois ouvert et fermé. C’est un refuge, mais un refuge traversé par la vie extérieure. Les questions de l’accueil et de la transmission étaient essentielles pour lui, si bien qu’il a créé une communauté où venaient se former des militant.e.s, des ouvrier.e.s, des intellectuel.le.s, des artistes, qui a essaimé et rayonné ensuite à des endroits extrêmement variés.
Vous ne vous intéressez pas seulement à ces tentatives, mais aussi aux mobilisations et aux répertoires de luttes. Pourquoi appelez-vous à dépasser la binarité violence / non-violence ?
Il me semble important de sortir de la hiérarchisation des formes d’action et de la valorisation de certains rôles plutôt que d’autres, notamment ces attitudes héroïques un peu virilistes et dites violentes. Il s’agit seulement d’une modalité, éventuelle, d’action. De mon expérience, c’est toujours l’articulation de différentes stratégies qui permet des formes de succès et de victoire. D’où l’importance, pour moi, des réseaux et des alliances. Et que ces dernières se fassent depuis nos différences, que ce soit de vulnérabilités ou de puissances d’agir. C’est la raison pour laquelle je préfère parler « d’écologie déviante » plutôt que « d’écologie queer », parce que cette idée croise celle d’une écologie du minoritaire : la nécessité d’intégrer des perspectives qui ne soient pas uniquement définies par des hommes hétéros et blancs, et de prendre en considération les questions décoloniales, féministes, celles des quartiers populaires, etc. Mais pour revenir à la question de la violence, je crois qu’il est nécessaire de se la poser. La réactivation du fantasme de la lutte non-violente me semble très problématique dans les espaces écologistes, comme les références à Gandhi ou à Martin Luther King. Ils n’ont pas fait tomber le pouvoir britannique ni le système de ségrégation raciale tout seuls ! On oublie trop souvent que la violence vient d’abord du pouvoir. La répression est devenue tellement brutale qu’on se voit obligés, quand on le peut, de passer à des actions de plus en plus intenses. Ça radicalise nécessairement nos options de mobilisation et d’action, ou alors ça nous oblige à créer de nouvelles stratégies. La question du sabotage, par exemple, m’intéresse énormément. Mais l’histoire des zaps [actions éclairs – Ndlr] d’Act Up est extrêmement riche aussi. En croisant les répertoires de lutte on peut échapper à la conception un peu simpliste de ce que serait la « bonne » ou la « mauvaise » manière de lutter.
Vous pointez les limites de certaines techniques militantes queer, notamment les « Pink Blocs » qui se constituent dans les manifestations, parfois pour soutenir d’autres luttes. Vous avez la crainte qu’ils deviennent « consommables, ou pire, le clou du spectacle ». Comment faire pour que ces techniques de luttes ne soient pas « assimilables » ?
La « frivolité tactique » des Pink Block est très intéressante. Les formes d’exubérance presque carnavalesque, les esthétiques perturbatrices et subversives qu’ils développent peuvent être assez déroutantes pour le pouvoir policier et permettent parfois de faire diversion. Néanmoins, ce que je cherche à questionner, c’est surtout la répétition : comment l’éviter ? Parfois, on a tendance à s’installer un peu confortablement dans des répertoires d’action parce qu’on les maîtrise bien. Ça a été très important de monter un Pink Block pendant les manifestations des Gilets jaunes, de montrer qu’on était là en tant que queer et que nous aussi, nous étions concerné.e.s par les réformes sociales. Mais face au rouleau compresseur du pouvoir, j’ai fini par expérimenter une forme de lassitude. Tout militant, au bout d’un moment, s’interroge sur la pertinence de ce qu’il produit.
La surprise serait la meilleure arme politique ?
L’élément de surprise est extrêmement puissant, oui ! Encore une fois, il s’agit de penser des stratégies complémentaires, d’avoir un coup d’avance et de produire une forme de court-circuit. Et parfois, moi le premier, nous sommes pétris d’images d’actions qui ont déjà existé, de répertoire qu’on fantasme ou mythifie, d’activistes qu’on héroïse. Act Up, à un moment donné, a participé d’une paralysie vis-à-vis de nos propres luttes, parce qu’on avait l’impression que ça avait été LE moment de victoire. Quand j’ai voyagé en Angleterre et aux États-Unis pour écrire le livre, ça a été un des grands enjeux : comment repenser nos modalités d’action ? Des formes d’Artivisme me semblent nécessaires. C’est pour ça que le travail du Laboratoire d’imagination insurrectionnelle de Jay Jordan et Isabelle Frémeaux – deux artistes et auteur.e.s militant.e.s vivant à la Zad – est extrêmement puissant. J’aime aussi beaucoup l’idée des écosexuels d’organiser des grands mariages entre des individus et des éléments naturels menacés. Ces unions deviennent des moments un peu sexy de sensibilisation qui font intervenir le corps, le rire et la satire. La colère ne peut plus être l’unique tonalité de lutte. Pour moi en tout cas. J’en ai, c’est important, mais le désir et la joie militante sont tellement importants, aussi, pour résister aux forces de destruction à l’œuvre.
Propos recueillis par Aïnhoa Jean-Calmettes
> Écologies déviantes. Voyage en terres queers, Éditions Cambourakis, septembre 2021